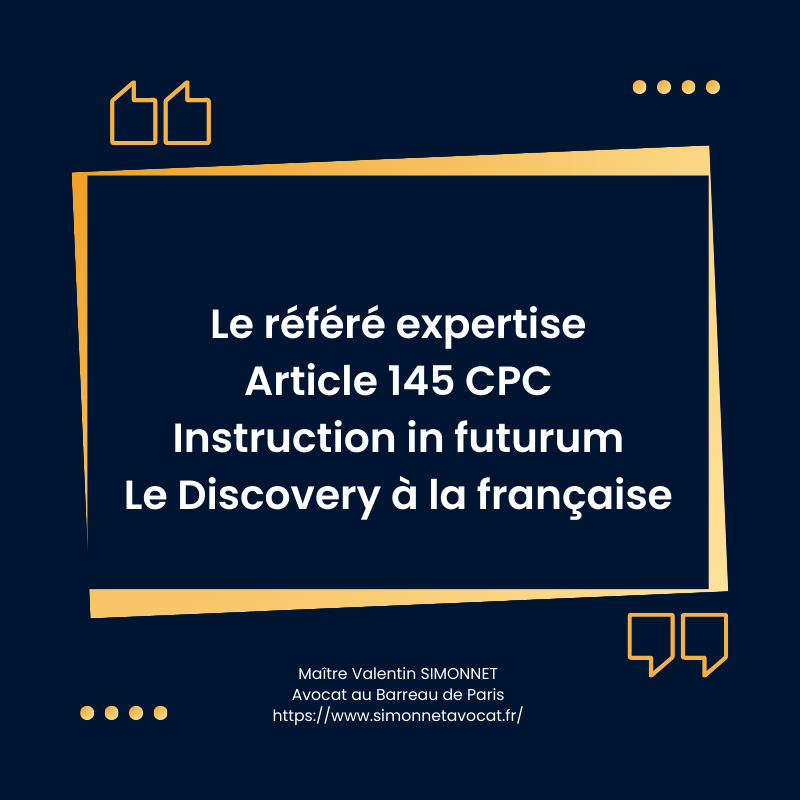Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé“. Instauré par le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973, cet article permet à un justiciable de solliciter, devant l’autorité compétente et sous certaines conditions, des mesures d’instruction dans l’objectif d’obtenir des éléments de preuve.
Il permet au président du tribunal d’ordonner des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ces mesures peuvent être ordonnées de deux manières : soit de manière contradictoire selon la procédure de référé, soit de manière non contradictoire selon la procédure sur requête .
Résumé des conditions d’application du 145
Il faut donc que quatre conditions de recevabilité soient remplies pour que l’article 145 CPC s’applique.
La mesure doit être réalisée :
- Avant tout procès au fond civil ;
- Motif légitime (le litige futur potentiel) : il faut prouver qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
- Le caractère « légalement admissible » des mesures ordonnées [contrôle de proportionnalité objectif sur le périmètre de la mesure] : les mesures doivent être légalement admissibles, c’est à dire
- « circonscrites dans le temps et dans leur objet »,
- « proportionnées à l’objectif poursuivi » et aux intérêts en présence;
- et « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant ».
- Le respect du secret des affaires et du droit à la vie privée vs intérêt probatoire [contrôle de proportionnalité subjectif] : l’intérêt probatoire du demandeur ne doit pas violer les intérêts légitimes des personnes à l’encontre desquelles les mesures sont ordonnées, tels que le secret des affaires ou le respect de la vie privée
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Pourquoi faire un 145 ?
Réaliser un “145” est très utile afin de déterminer ses droits potentiels avant d’engager un procès au fond.
Par exemple, une société peut intenter un 145 pour obtenir certaines pièces de son concurrent afin de pouvoir estimer son préjudice avant d’engager une action en concurrence déloyale. Une fois ces documents en poche, elle pourra déterminer si cette action a un intérêt ou non.
Condition 1 : Motif légitime, le litige futur potentiel
Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il doit uniquement démontrer qu’il a un « motif légitime » à ce que cette mesure soit ordonnée.
Pour ordonner une expertise in futurum, les juges du fond doivent constater l’existence d’un litige potentiel (Cass. com. 16-10-2019 no 18-11.635 F-D). A cette fin, le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint (Cass. 2e civ. 12-7-2012 no 11-18.399 F-PB : Bull. civ. II no 132).
Il s’agit là, outre la condition liée à une demande portée devant le juge avant tout procès, du cœur du dispositif légal.
Cette condition est laissée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait (Cass. 2e civ., 14 mars 1984, n° 82-16.076 ).
Il y a deux critères pour remplir le motif légitime :
- existence d’un litige potentiel ou plausible dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés ;
- et sur lequel le résultat de la mesure d’instruction sollicitée est susceptible d’influer, c’est à dire “dont pourrait dépendre la solution d’un litige“.
Autrement dit, pour que la mesure d’instruction soit ordonnée, il convient de constater la réunion de trois exigences :
- qu’un procès avec un objet et un fondement suffisamment déterminés est possible,
- que la solution du procès potentiel peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée
- que la mesure demandée ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Certains auteurs (Yves Strickler) retiennent les 3 conditions suivantes :
- Il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal ;
- la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain (utilité) ;
- la mesure doit être proportionnée en ce qu’elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.
La potentialité d’un différend suffit à caractériser un intérêt légitime
Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 21-11.926, FS-B
Autrement dit, le requérant doit rendre la possibilité d’une action judiciaire à venir la plus palpable possible pour le juge des requêtes tout en prenant bien garde à souligner la carence probatoire que présente l’action en question.
L’existence d’un litige plausible et crédible
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part.
Si le juge, statuant en la forme des référés, doit constater l’existence d’un motif légitime, requis par la lettre de l’article 145 du Code de procédure civile, il ne lui appartient pas de le caractériser (Cass. civ. 2, 8 juin 2000, n° 97-13.962).
Il doit constater le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
De même, l’existence d’un litige potentiel suffit, la preuve de l’existence d’un différend actuel n’est pas requise (Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.368, F-D).
La demande sera refusée dès lors qu’« aucun [d]es documents [produits] n’apporte la moindre consistance à ses soupçons » et que « [le requérant] ne procède que par déductions et affirmations » (CA Toulouse, 3e ch., 11 juill. 2019, n° 18/04094) ;
A l’inverse, le requérant démontre l’existence d’un motif légitime à faire exécuter des mesures de saisies informatiques contre une société qu’il soupçonnait de détournement de clientèle dès lors que (i) l’un de ses salariés était parti chez son concurrent, que (ii) le rachat de sa clientèle avait été envisagé par son concurrent et que (iii) son chiffre d’affaires avait inexplicablement diminué (CA Versailles, 14e ch., 15 juin 2017, n° 16/07638).
Un contrôle limité à la stricte évidence
Le demandeur qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’art. 145 c. pr. civ. n’a pas à établir le bien-fondé des prétentions qu’il pourrait soumettre au juge dans le cadre d’un procès au fond. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur cette question.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Toute action basée sur un fait qui serait irrémédiablement vouée à l’échec rendant l’information qui serait collectée inutilisable en justice serait un motif de refus.
La prétention manifestement malfondée
Le juge des référés peut rejeter une demande de mesure d’instruction lorsque le demandeur sollicite cette mesure « en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement… mal fondées » (Civ. 1re, 22 janv. 2020, préc. ; Civ. 2e, 5 oct. 2023, préc.) dans le cadre d’une action « manifestement vouée à l’échec » (Com. 18 janv. 2023, n° 22-19.539, Rev. sociétés 2023. 420, note J.-P. Dom ; RTD civ. 2023. 444, obs. J. Klein ; ibid. 713, obs. P. Théry ; D. actu. 26 janv. 2023, obs. F. Expert).
Toute la difficulté pour le juge des référés est donc de déterminer si la prétention est « manifestement mal fondée » sans empiéter sur le domaine réservé du juge du principal.
Le juge des référés peut seulement « effleurer le fond de l’affaire, pour pouvoir évaluer la pertinence du recours à une mesure probatoire préventive » (I. Després, Les mesures d’instruction in futurum, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de thèses », vol. 34, 2004, n° 294). Dans la présente affaire, la juridiction des référés a fait plus qu’effleurer le fond de l’affaire alors que. La cassation était donc inévitable.
La prétention manifestement irrecevable
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il peut rejeter une demande de mesure d’instruction lorsque le demandeur sollicite cette mesure « en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables » (Civ. 1re, 22 janv. 2020, n° 18-25.213 ; Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 23-13.104).
Sont “manifestement irrecevables” :
- l’action envisagée est prescrite quoi qu’il arrive (Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24.684 ; Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-24.757 ; Civ. 2e, 5 oct. 2023, préc.),
- la prétention a été rejetée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-23.434 ; Civ. 2e, 17 nov. 2011, n° 10-25.679)
- une transaction a éteint le droit d’agir (Civ. 1re, 28 mars 2018, n° 17-11.628, RTD civ. 2018. 693, obs. P.-Y. Gautier ; D. actu. 18 avr. 2018, obs. M. Kebir).
L’interdiction de se prononcer sur le bien-fondé de l’action
Le juge du provisoire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une question de fond.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-24.930 : Les demandeurs, en l’espèce, s’étaient vus privés par la survenue d’un second testament dotant la commune de la défunte, d’un droit à héritage qu’un premier testament était venu leur octroyer. La cour d’appel avait rejeté la demande d’expertise de l’état de santé mentale de la testatrice au motif que le testament critiqué ne témoignait pas en lui-même d’une altération des facultés mentales de son auteur et ceci d’autant moins, selon la cour, qu’elle avait déjà envisagé antérieurement, lors de l’établissement du premier testament, la volonté finalement exprimée dans le dernier (juillet 2011). Les juges d’appel ont encore relevé qu’un médecin expert avait été amené à considérer qu’une curatelle renforcée devait être instaurée (septembre 2011), mais que c’est une curatelle simple qui avait été prononcée en janvier 2012, suivie d’une mise sous tutelle en janvier 2013, de sorte que ce fait aurait témoigné « seulement de la dégradation de son état de santé depuis un an ». Ce faisant, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs relatifs au bien-fondé de l’action et non au regard du seul critère de l’article 145. l’action en nullité du testament susceptible d’être exercée n’était pas manifestement vouée à l’échec. La cassation s’imposait.
L’utilité de la mesure : le requérant n’a pas déjà toutes les billes
Le juge peut, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, décider que la mesure d’instruction avant tout procès étant inutile, le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-14.985, F-P+B).
Ou alors quand le requérant disposait déjà des éléments. En effet, ces éléments ne doivent, pour autant, constituer qu’un faisceau d’indices dès lors que si le requérant dispose d’ores et déjà d’éléments probants caractérisant l’existence des actes préjudiciables, la mesure perd son objet : « l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime à recourir à une mesure d’expertise avant tout procès alors qu’elle détient déjà les éléments suffisants lui permettant de saisir le juge du fond en cas de litige avec la société [requise] » (CA Bordeaux, 18 févr. 2019, n° 18/03291. – Cass. com., 18 févr. 1986, n° 84-10.620 : – CA Paris, pôle 1, ch. 3, 21 mars 2018, n° 17/18937).
Condition 2 : Avant le procès au fond civil visé à la Condition 1
En matière de 145, le juge du fond ne doit pas encore être saisi du litige en germe sur lequel le requérant se fonde pour solliciter sa requête (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-26.018, F-B )
Temporalité
Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande, si bien que l’absence de saisine s’apprécie au jour de la demande ou du dépôt de la requête, et non au jour où le juge statue. (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 07-12.536, et Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2014, 13-19.967, Publié au bulletin).
L’acte introduisant la procédure 145 doit être remis au rôle de la juridiction compétente avant toute assignation au fond.
Quel type de procès ?
Seule une action au fond interdit au juge requis de statuer sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cela exclut :
- une instance en référé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ce texte (CA Lyon, 13 juin 2017, n° 17/01876. – Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.972, F-P+B : JurisData n° 2008-045009 ; Procédures 2008, comm. 291, obs. R. Perrot).
Matérialité
Si un procès est déjà engagé devant une juridiction, c’est devant celle-ci que la mesure d’instruction devra être demandée. La demande de mesures d’instruction n’est donc recevable que si le litige pour lequel elle est demandée n’est pas le même que celui éventuellement déjà pendant devant le juge du fond.
Une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Dès qu’une juridiction est saisie de l’affaire au fond, le juge des référés ne peut plus ordonner une mesure sur le fondement de l’article 145 du CPC ; seul le juge saisi au fond est compétent pour le faire.
L’interdiction faite au juge d’ordonner les mesures d’instruction ne s’applique que si l’instance au fond est ouverte sur le “même litige” à la date de la requête (Cass. 2ᵉ civ. 30-9-2021 n° 19-26.108 F-B).
Il faut ainsi pour qu’il y ait “même litige” que :
- le demandeur soit partie au procès (Cass. 2e civ. 1-7-1992 n° 91-10.128 : Bull. civ. II n° 189). L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques.
- et que les faits que l’on cherche à établir ne soient pas distincts du procès initial (Cass. com. 3-4-2013 n° 12-14.202 : RJDA 8-9/13 n° 763).
Autrement dit, le “même litige” n’implique pas que:
- les parties aux deux procès soient identiques, Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond. (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-18.619) et (Cass. 2′ civ. 1-7-1992 n° 91-10.128 P: B ull. civ. II n° 189; Cass. com. 3-4-2013 n° 12- 14.202 F-D: RJDA 8-9/13 n° 763)
Le même litige couvre :
- tout procès contre les tiers présentant un lien, même éloigné, avec les mesures sollicitées. C’est à dire que le juge doit vérifier si les pièces demandées ne doivent pas être utilisée dans un autre procès. Ainsi, des parties ont été tentées de solliciter une mesure 145 à l’encontre d’une personne contre laquelle aucune instance n’avait été engagée afin de récolter des preuves qu’elles entendaient utiliser dans le cadre d’une instance en cours au fond contre une autre personne. La Cour de cassation a considéré qu’une telle manœuvre était caractéristique d’un contournement de la procédure 145 et a invité les juridictions à vérifier « si, à la date de la requête, il n’existait pas un litige dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée » dès lors que l’existence d’un tel litige fait obstacle à ladite mesure (Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485, FS-P+B). Aussi, il sera recommandé aux requérants de diligenter leurs mesures 145 avant
L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête. (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-18.619)
Exemples :
- Au fond est engagée devant le conseil de prud’hommes au jour de la requête devant le président du tribunal de commerce un litige entre le salarié et l’employeur sur la prise d’acte de la rupture de contrats de travail. L’Employeur dépose postérieurement une requête devant le TCOM pour des actes relatifs à la concurrence déloyale commise par les anciens salariés. Ensuite, l’ancien employeur a formé une demande reconventionnelle devant le conseil de prud’homme sur le fondement de la concurrence déloyale. C’est VALIDE : au jour de la saisine du juge des requêtes, aucune demande formée devant le conseil de prud’hommes ne portait sur les agissements de concurrence déloyale suspectés. La demande reconventionnelle de l’ancien employeur n’est formée qu’après la saisine du juge des requêtes. Ainsi, la demande de mesure d’instruction sollicitée est antérieure à tout procès. (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, no 21-18619, Sté Matignon finances c/ Sté Mirabaud & Cie,)
3ᵉ condition : Le caractère « légalement admissible » des mesures ordonnées [contrôle de proportionnalité objectif sur le périmètre de la mesure]
La condition posée par l’article 145 du code de procédure civile suivant laquelle les mesures ordonnées doivent être « légalement admissibles » recouvre aujourd’hui une triple exigence (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-14.309 ; 25 mars 2021, n° 19-20.156 ; Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-27.526 ; 21 mars 2019, n°18-14.705).
Ces mesures d’instruction doivent ainsi impérativement être :
- Légalement admissibles au sens strict, c’est à dires des mesures qu’un juge civil peut prononcer (des copies oui mais pas une écoute téléphonique)
- « circonscrites dans le temps et dans leur objet »,
- dans son objet à l’appréhension, autant que faire se peut, de documents exclusivement nécessaires à la preuve des manquements allégués (CA Paris, 3 févr. 2022, n° 21/12883)
- dans le temps à la période des faits litigieux dénoncés dans la requête qui rendent les soupçons du requérant crédibles (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705 – Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.198, F-D. – Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-22.965). c’est le cas lorsque « la mesure portait sur les documents et fichiers “postérieurs au mois de janvier 2019 »,
- « proportionnées à l’objectif poursuivi »;
- « nécessaires (mais pas indispensables ou la seule voie) à l’exercice du droit à la preuve du requérant » (risque de redite avec le motif légitime et l’obligation d’une mesure “dont pourrait dépendre la solution d’un litige”)
Autrement dit, les mesures d’instruction sont légalement admissibles dès lors qu’il est suffisamment établi qu’elles sont de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur et sont proportionnées aux intérêts en présence.
Ces 3 sous conditions du caractère légalement admissible appréciées globalement imposent au juge un contrôle de proportionnalité objectif portant sur l’adéquation entre le périmètre des mesures sollicitées et le procès envisagé.
Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Les mesures ordonnées ne doivent pas s’analyser en une « mesure générale d’investigation », mais être « circonscrites aux faits litigieux » (Com. 23 juin 2021, n° 20-22.253 ; 24 mars 2022, n° 20-22.955), de sorte que les preuves susceptibles d’être appréhendées soient « en rapport direct avec les faits dénoncés » (Com. 17 janv. 2018, n° 15-29.114).
En pratique, cette obligation conduit le juge à vérifier que ces mesures sont définies de manière précise et adéquate, en s’assurant notamment, en cas de saisies numériques, que les mots-clefs retenus par l’ordonnance sont suffisamment restrictifs (Civ. 2e, 10 juin 2021, n° 20-11.987 P. ; 24 mars 2022, n° 20-21.925 P).
Le demandeur ne doit pouvoir appréhender que des éléments utiles et opérants dans la perspective d’un procès lui-même suffisamment crédible.
Le caractère “nécessaire” n’impose pas au juge de s’assurer du caractère « indispensable » des mesures sollicitées. Le fait que le demandeur ait pu obtenir les pièces d’une autre manière ne peut motiver un refus.
Com. 28 juin 2023, F-B, n° 22-11.752
Mon conseil
Il est recommandé aux requérants de :
- privilégier les recherches par associations de mots-clés (une recherche qui aboutirait à trop de résultats aura tendance à être écartée par le juge voir à emporter la rétractation de l’ordonnance tout entière si le nombre de résultats est de toute évidence déraisonnable) ;
- justifier chaque mot-clé en présentant son utilité et sa pertinence dans le cadre du potentiel litige à venir ;
- circonscrire la période des saisies de manière raisonnable au regard de la temporalité des pièces qui viennent justifier le motif légitime de la mesure.
Exemples de mesures légalement admissibles
- Injonction de production de pièce. Attention, si le juge peut ordonner au requis de produire une pièce, la pièce doit déjà exister et être détenue par le requis. Il n’est pas possible d’ordonner la production d’une pièce qui, même si elle pourrait être créée ou établie en l’absence de tout obstacle matériel ou juridique (par exemple un état comptable en cours d’exercice), n’est pas détenue par le requis, à juste titre puisqu’il n’a aucune obligation légale de la détenir (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Publié au bulletin).
- Constat d’un fait
- Consultation (expertise allégée)
- Expertise
Exemples de mesures non légalement admissibles
Le juge ne peut pas ordonner une mesure non légalement admissible :
- perquisition civile faute de circonscription dans le temps et dans l’objet
- Écoutes téléphoniques
- Ordonner une « saisie »
- Se comporter comme en saisie contrefaçon (vraie perquisition civile pour empêcher)
4ᵉ condition : secret des affaires et droit à la vie privée vs intérêt probatoire [contrôle de proportionnalité subjectif]
Les secrets indépassables
Le secret des sources journalistiques (TGI Paris, 20 nov. 2014, n° 14/59764) et le secret de l’instruction pénale demeurent, à ce jour, des remparts infranchissables pour les mesures 145 non contradictoires (TJ Paris, 10 juill. 2020, n° 20/52615).
Les secrets dépassables
Une fois vérifiée l’adéquation entre le périmètre des mesures ordonnées et le procès envisagé, la jurisprudence met à la charge des juges une mise en balance entre l’intérêt probatoire du demandeur et les intérêts légitimes des personnes à l’encontre desquelles les mesures sont ordonnées, tels que le secret des affaires ou le respect de la vie privée (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-14.309 P. ; 10 juin 2021, n° 20-11.987 P.).
Il faut rappeler que les secrets ne rendent pas de facto la mesure légalement inadmissible :
- le secret des affaires,Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.225.
- le droit et la respect de la vie privée, V. Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-13.082, F-D :
- le secret des avocats, V. Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.285,
Le juge devra s’assurer que les mesures sollicitées sont « proportionnées à l’objectif poursuivi » (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309, F-P ). Cette mise en balance est opérée, a priori, au stade de l’autorisation des mesures d’instruction et par conséquent sans avoir connaissance du contenu effectif des pièces appréhendées.
Le juge prendra en considération les éléments suivants :
- Le caractère « circonscrit » des mesures ordonnées, aussi bien dans leur objet que dans le temps,
- Le fait que les recherches ordonnées « ne ciblaient pas les documents personnels ».
- Le fait que « l’autorisation donnée à l’huissier de justice de pénétrer au domicile [de ce salarié], hors sa présence et sans son autorisation, était assortie d’une garantie du respect de ses droits par la présence de deux témoins ».
- Le fait qu’« en l’absence d’autorisation de “craquer” les mots de passe et les “codes PIN”, la mesure ordonnée aurait perdu toute utilité ».
5ᵉ condition (requête only) : la justification de la dérogation au contradictoire
L’intérêt de la requête
L’intérêt majeur de la requête est que la personne visée par les mesures d’instruction ne prendra connaissance de celles-ci qu’au moment de leur exécution. Elle ne sera donc pas en mesure de les anticiper en faisant disparaître les preuves recherchées et/ou en les dissimulant.
Une partie aura ainsi recours à cette procédure lorsque l’effet de surprise des mesures est nécessaire pour garantir leur efficacité ; ce qui sera généralement le cas lorsque lesdites mesures ont pour objet de :
- saisir des éléments de preuves qui n’ont pas d’existence légale et qui peuvent donc facilement être détruits ou dissimulés (courriers, emails, textos, messages WhatsApp, conversations Slack, etc.) ;
- surprendre une personne en train de commettre un fait préjudiciable ou illégal.
- À titre d’exemple, en matière commerciale, il sera fréquemment recouru à l’article 145 du Code de procédure civile pour saisir des éléments de nature à établir l’existence de pratiques concurrentielles déloyales, qui sont souvent dissimulées, ou, en matière contractuelle, des manœuvres dolosives.
L’exigence de motivation de la dérogation au contradictoire
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (CPC art. 493). Les mesures d’instruction ne peuvent donc être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement (CPC art. 845, al. 2).
L’ordonnance sur requête doit être motivée (CPC art. 495, al. 1). Le juge ne peut pas faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire (Cass. 2e civ. 13-5-1987 n° 86-11.098 : Bull. civ. II n° 112 ; Cass. 2e civ. 23-11-1994 n° 92-17.774 : Bull. civ. II n° 241). Il s’agit de vérifier l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe du contradictoire (Cass. 2e civ. 7-5-2008 n° 07-14.858 : RJDA 8-9/08 n° 974).
Le requérant devra impérativement être précis et exhaustif dans l’exposé des motifs de sa requête justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire en démontrant, notamment et principalement, que :
Risque de destruction/dissimulation
- les éléments qu’il entend saisir présentent un risque de destruction/dissimulation ; ce qui sera généralement le cas lorsque leur support est numérique (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 23-11.744 : JurisData n° 2023-016868) ;
Dans la pratique, les requérants se contentent régulièrement de se référer à la seule nature numérique des pièces qu’ils souhaitent saisir pour justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire au motif que ces pièces seraient, par essence, susceptibles de destruction/dissimulation.
Une telle justification est généralement admise par la jurisprudence et l’a encore été récemment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2023 qui approuvait un arrêt d’appel ayant retenu que « l’ordonnance qui visait la requête était motivée en considération de la nature des faits de parasitisme, de leur ampleur et d’un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtives et susceptibles d’être aisément détruites ou altérées, comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire » (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 23-11.744 : JurisData n° 2023-016868).
Néanmoins, il s’avère que cela n’est pas toujours suffisant. La cour d’appel de Paris retient ainsi, dans plusieurs arrêts, que le seul caractère numérique des pièces recherchées n’est pas suffisant pour justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire : « l’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels […] il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser » (CA Paris, ch. 3-3, 2 févr. 2022, n° 21/07135. – CA Paris, pôle 1, ch. 3, 6 sept. 2016, n° 16/01032 : JurisData n° 2016-018257. – CA Paris, pôle 1, ch. 2, 18 oct. 2018, n° 18/03548. – CA Paris, pôle 1, ch. 3, 13 févr. 2019, n° 18/16514).
Le comportement du requis
- le comportement du requis et le contexte font craindre un risque de dissimulation/destruction des éléments en question (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-19.401 : JurisData n° 2020-015514).
L’interdiction de la mise en demeure préalable
Préalablement à l’introduction d’une procédure 145 , il est fortement conseillé à la partie qui entend diligenter une telle mesure de ne pas informer le requis de son intention de faire valoir judiciairement ses droits au travers d’un courrier ou d’une mise en demeure. Et pour cause, face à une telle menace, le requis pourrait anticiper une éventuelle mesure 145 du requérant à son encontre en procédant à la dissimulation ou la destruction des éléments de preuve susceptibles d’être saisis.
Dans ce contexte, les juges pourraient considérer qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe du contradictoire pour pallier un risque de dissimulation/destruction de ces éléments qui existe d’ores et déjà et, par conséquent, décider de ne pas faire droit à la requête ou de rétracter l’ordonnance ayant autorisé les saisies (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-25.206. – CA Lyon, 8 oct. 2021, n° 20/07067).
Très récemment encore, la Cour de cassation a cassé une décision d’appel qui considérait que la nature même des pièces justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire sans rechercher si les mesures étaient assorties d’un effet de surprise : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves était établie le 7 février précédent les sociétés requérantes avaient adressé, à la société [requise], une mise en demeure dénonçant de manière détaillée les mêmes faits de concurrence déloyale et évoquant des circonstances identiques à celles ultérieurement reprises dans la requête , la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-26.001 : JurisData n° 2024-000324).
Les conditions non requises par l’article 145
La mesure sollicitée n’a pas à être la seule qui permette l’obtention des preuves
Si les mesures ordonnées doivent être « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant », le contrôle de la « nécessité » des mesures ordonnées pour l’exercice du droit à la preuve du demandeur ne suppose pas de s’assurer que ce dernier ne disposait d’aucun autre moyen de se procurer ou d’obtenir des preuves en vue du procès projeté.
L’article 146 CPC (avoir mis en œuvre tout ce qu’il était possible de faire pour obtenir la preuve de ses faits) ne s’applique pas à l’article 145 CPC (comme en matière d’expertise médicale). (Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-15.369, Inédit)
Autrement dit, le juge ne doit pas s’assurer du caractère « indispensable » des mesures sollicitées
L’ajout de cette condition autonome a été clairement refusée par la Cour de Cassation.
« La preuve n’est pas établie »
C’est précisément l’objet du 145
« Le fondement de l’action future n’est pas déterminé »
La visée exploratoire du 145 a justement été créée pour ça, c’est-à-dire pour permettre au demandeur de confirmer ou d’infirmer si une action sera possible.
L’urgence
Civ 2° , 15 janv. 2009, n° 08-1 0.771 : « Mais attendu que l’urgence n ‘est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instructions sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » .
La question du séquestre
Le séquestre permet l’examen contradictoire a posteriori, pièce par pièce, au stade de la levée d’une mesure de séquestre, de chaque pièce pour confronter concrètement les intérêts en présence.
En l’état du droit positif, l’organisation d’un séquestre n’est pas formellement requise pour qu’une mesure soit « légalement admissible », y compris en cas d’atteinte à un droit fondamental. (Com. 28 juin 2023, F-B, n° 22-11.752)
Prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce en matière de secret des affaires, la mise sous séquestre des documents appréhendés est toutefois expressément prise en compte par certaines juridictions du fond pour apprécier la licéité et la proportionnalité d’une atteinte, non seulement à ce secret (Paris, 5 janv. 2022, n° 21/10227 ; 2 févr. 2022, n° 21/07135 ; 16 févr. 2023, n° 22/13350), mais également au respect de la vie privée (Paris, 6 mars 2019, n° 18/20241 ; 15 juin 2023, n° 22/17229).
Devant le tribunal de commerce de Paris, le séquestre est automatique.
La compétence du juge
Mesure d’instruction 145 : quel juge saisir ?
Règles de procédure propres à la requête
Sous réserve des dispositions des articles 761 et 853 du Code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire pour déposer une requête tant devant le président du Tribunal judiciaire que devant le président du Tribunal de commerce (CPC, art. 761 et 853).
La requête doit être présentée en double exemplaires au président du Tribunal saisi et doit comporter l’indication des pièces invoquées (CPC, art. 494).
À peine de nullité, préalablement à l’exécution des mesures sollicitées, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée (CPC, art. 495. – Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-21.719, F-B : JurisData n° 2024-001160 ; Procédures 2024, comm. 82, obs. S Amrani Mekki). Cette obligation n’emporte toutefois pas l’obligation de communiquer une copie des pièces sur lesquelles la requête et l’ordonnance se fondent (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 20-15.673 : JurisData n° 2021-000477).
Si la requête est acceptée, l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute (CPC, art. 495). Tout intéressé pourra alors en référer au juge qui a rendu l’ordonnance pour en obtenir la modification ou la rétractation (CPC, art. 496 et 497).
Si la requête est refusée, un appel peut être interjeté contre l’ordonnance de rejet dans un délai de 15 jours (CPC, art. 496).
Modèle de « par ces motifs »
« C’EST POURQUOI
Vu les articles […]
Vu les pièces citées,
Vu la jurisprudence citée,
La société […] sollicite de Madame / Monsieur le président du Tribunal […] de :
Commettre tout huissier de justice territorialement compétent, le cas échéant assisté d’un technicien et de la force publique,
Lui donner mission de :
Se rendre dans les locaux de la société […] ;
remettre copie de la requête et de l’ordonnance à la société […] ;
solliciter la communication de […]
se faire remettre ou rechercher et prendre copie en double exemplaire, notamment sur tous supports papiers et/ou informatiques, présents sur place ou accessibles à distance, disques durs, clés USB, ordinateurs, serveurs, smartphones, tablettes, sur tous les documents et/ou correspondances par courriel et/ou par messagerie instantanée (notamment accessibles via les adresses de courriels […] et […], WhatsApp, Telegram, Signal, etc.), tous documents et toutes correspondances comportant la conjonction de mots-clés suivants […] ;
imprimer ou prendre copie des éléments identifiés sur tout support informatique de son choix ;
dresser un procès-verbal des opérations effectuées et en communiquer une copie au requérant ;
Autoriser le ou les huissier(s) instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout huissier territorialement compétent de son choix ;
Autoriser le ou les huissier(s) instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la force publique ;
Dire que l’huissier instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces récoltées ;
Faire injonction au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l’accès aux ordinateurs, serveurs, connexions diverses en communiquant à l’huissier instrumentaire, sur sa demande, les codes d’accès et mots de passe nécessaires ;
Dire que les recherches incluront également tout mail effacé qui pourrait être récupéré par l’expert informatique au moyen d’un logiciel approprié »
Peut-on utiliser le régime général de l’article 145 quand un régime spécial existe ?
Expertise 145 et expertise de gestion
l’expertise in futurum coexiste avec l’expertise de gestion, qui permet à un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % du capital social ainsi qu’au ministère public ou au comité social et économique (CSE) d’obtenir une expertise sur une opération de gestion en l’absence de réponse satisfaisante des dirigeants à une question portant sur cette opération (C. com. art. L 225-231 pour les sociétés par actions et C. com. art. L 223-37 pour les SARL).
Les deux expertises coexistent de façon autonome sans être exclusives l’une de l’autre, leurs domaines d’application pouvant se chevaucher, ouvrant ainsi une option aux demandeurs. A ce titre, l’expertise in futurum ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion, de sorte que les juges du fond ne sauraient rejeter une demande fondée sur l’expertise in futurum au motif que l’expertise de gestion était ouverte au demandeur (Cass. com. 18-10-2011 no 10-18.989 F-PB : RJDA 1/12 no 64).
Toutefois, l’expertise in futurum a une finalité probatoire, alors que l’expertise de gestion a une finalité informative (I. Urbain-Parléani, L’expertise de gestion et l’expertise in futurum : Revue sociétés 2003 p. 223). Le rapport auquel l’expertise de gestion donne lieu est ainsi adressé au demandeur mais aussi au ministère public, au CSE, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes ; il est en outre annexé au rapport de ces derniers en vue de la prochaine assemblée (C. com. art. L 225-231, al. 5 pour les sociétés par actions et C. com. art. L 223-37, al. 5 pour les SARL).
En rappelant les finalités respectives des deux expertises, la Cour de cassation semble indiquer qu’elle entend éviter que l’expertise in futurum ne soit détournée de sa finalité afin de d’échapper aux exigences plus strictes de l’expertise de gestion (sur ce risque, voir notamment J. Moury, La vitalité des mesures d’instruction in futurum ne doit pas masquer les conséquences fâcheuses qu’elle peut induire relativement à l’expertise de gestion : RTD com. 2020 p. 879). La mission confiée ici à l’expert visait davantage à apprécier l’opportunité des conventions qu’à rassembler la preuve d’irrégularités en vue d’un procès. Cass. com. 11-9-2024 no 22-24.160 F-B, Sté Esso C/ Sté Eximium. Censure de la Cour de cassation, qui juge que les mesures ordonnées ne tendaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme de l’expertise de gestion, et non pas à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La coexistence des deux régimes d’expertise n’est pas pour autant remise en cause, étant d’ailleurs observé que les actionnaires minoritaires détenaient un pourcentage du capital inférieur au seuil de détention exigé pour l’expertise de gestion par les textes du Code de commerce.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile ?
Comment l’article 145 du Code de procédure civile est-il appliqué en France ?
Quels sont les critères pour obtenir une mesure d’instruction selon l’article 145 du CPC ?
Dans quels cas peut-on invoquer l’article 145 du Code de procédure civile ?
Comment préparer une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ?
Quelle est la jurisprudence récente concernant l’article 145 du CPC ?
Quels types de preuves peuvent être recueillies selon l’article 145 du CPC ?
Quels sont les délais pour une mesure d’instruction en vertu de l’article 145 du CPC ?
Comment contester une mesure d’instruction ordonnée sous l’article 145 du CPC ?
Quels sont les avantages de l’article 145 du Code de procédure civile pour les entreprises ?
Comment une demande basée sur l’article 145 du CPC peut-elle influencer un procès ?
Quelle est la procédure pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 ?
Comment l’article 145 du CPC protège-t-il les droits des parties en litige ?
Quelles sont les obligations des parties lors d’une mesure d’instruction sous l’article 145 du CPC ?
Quels sont les risques d’abus de l’article 145 du Code de procédure civile ?
Comment l’article 145 du CPC est-il interprété par les tribunaux ?
Quels sont les exemples concrets de mesures d’instruction obtenues par l’article 145 du CPC ?
Comment se déroule une enquête en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile ?
Quels sont les coûts associés à une procédure sous l’article 145 du CPC ?
Quels conseils donneriez-vous pour maximiser les chances de succès d’une demande basée sur l’article 145 du Code de procédure civile ?