L’ordonnance sur requête est une décision provisoire et non contradictoire que le juge peut rendre dans certains cas où le demandeur est fondé à ne pas appeler la partie adverse (CPC art. 493).
Cette procédure permet d’obtenir rapidement des mesures urgentes ou des mesures d’instruction avant tout procès.
Toutefois, l’ordonnance sur requête peut être contestée par la voie de la rétractation ou de l’appel.
Dans cet article, nous vous expliquons les conditions et les modalités de la procédure sur requête devant le tribunal judiciaire, ainsi que les recours possibles contre les ordonnances rendues.
Le fondement juridique
En matière civile
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Article 845 CPC
En matière commerciale
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement
Article 875 CPC
Cas d’utilisation de la procédure sur requête au tribunal judiciaire
Il existe deux types de requêtes :
- Les requêtes innomées qui correspondant à l’alinéa 2 de l’article 845
- Les requêtes nommées qui correspondant à l’alinéa 1 de l’article 845
C’est ce qu’on appelle les cas d’ouverture de la procédure sur requête.
Mais quelle est la différence entre une requête innomée et une requête nommée ?
Requête innomée : en cas de mesure urgente exigée par les circonstances (Art. 845 alinéa 2)
Ce sont les requêtes de droit commun, qui ne sont pas prévues par un texte particulier ou spécifique.
L’article 845 alinéa 2 complète “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection (…) peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement“.
L’art. 493, qui s’applique seulement aux requêtes « innommées », vise à cet effet “les cas” ce qui laisse une grande marge de manoeuvre au juge. :
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 493 CPC
L’obtention de l’ordonnance sur requête innommée nécessite la réunion de deux conditions cumulatives :
- Justification à la dérogation du contradictoire
- Urgence
L’urgence
Dans sa requête, le demandeur doit motiver l’urgence en faisant apparaître qu’un retard dans la mise en œuvre de la mesure sollicitée créerait un préjudice ou serait facteur d’aggravation de celui existant déjà.
Souvent, l’urgence découle nécessairement des circonstances qui justifient l’absence de contradiction. Elle est donc déduite de l’existence de circonstances imposant la voie non contradictoire.
Des mesures urgentes peuvent toujours être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; c’est d’ailleurs le seul cas où le premier président de la cour d’appel peut ordonner une mesure sur requête (CPC, art. 958).
Il faut cependant garder à l’esprit que l’ordonnance sur requête constitue une décision provisoire ; comme le juge des référés, le juge des requêtes ne peut donc ordonner des mesures qui relèvent des seuls pouvoirs des juges du fond.
Appréciation de l’urgence au jour du dépôt de la requête : « le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349, Publié au bulletin).
La justification du non-contradictoire doit être caractérisée dans la requête ET l’ordonnance. Ce n’est pas justifiable a posteriori : mesure de « police juridictionnelle » (à la différence du motif légitime qui peut évoluer au cours de la procédure).
Justification à la dérogation du contradictoire
Plusieurs circonstances permettent, selon la jurisprudence, de déroger au principe de la contradiction :
- l’effet de surprise : , la citation de l’adversaire est impossible lorsque les mesures ordonnées par le juge voient leur efficacité subordonnée à un effet de surprise. Il ne suffit cependant pas à la requête de viser abstraitement la nécessité d’un effet de surprise (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-12.086, F-D)
- L’impossibilité de faire citer en justice le potentiels défendeur
- l’absence d’adversaire car celui-ci n’est pas identifiable
- l’existence d’un obstacle pratique à la citation de l’adversaire – une urgence absolue ou l’éloignement de l’adversaire (J. Héron, Th. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 438).
- l’effet de contrainte de personnes indéterminées.
C’est le plus souvent le péril pesant sur la conservation des preuves qui autorise la dérogation au contradictoire. Tel sera le cas, avant une décision de nomination d’un huissier pour procéder à certaines constatations, si l’avertissement de la partie adverse risque de lui permettre de faire disparaître des documents, de changer la configuration de locaux, de ne pas être présent ou de ne pas causer, en présence de l’huissier, les troubles qu’on lui reproche.
Si la requête ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et que l’ordonnance n’est motivée que par renvoi à la requête, la rétractation s’impose (Cass. 2e civ. 23-6-2016 n° 15-19.671 F-PB : Bull. inf. C. cass. 15-12-2016 n° 1585).
Par ailleurs, si la dérogation au principe du contradictoire n’est pas établie au stade de la requête, l’instance en rétractation engagée, par la suite, à l’encontre de l’ordonnance qui y a fait droit n’est pas de nature à purger le vice initial même si la demande en rétractation donne lieu, par hypothèse, à débats devant le juge des référés (Cass. 3e civ. 22-9-2016 n° 14-24.277 F-PB : Bull. inf. C. cass. 1-3-2017 n° 193).
Exemples de justifications
- Une société qui reprochait à une autre société et à des particuliers d’avoir commis des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire a pu demander sur requête au président du tribunal la désignation d’huissiers de justice en vue de la réalisation d’investigations au siège social de la société et au domicile des particuliers concernés (Cass. 2e civ. 5-5-2011 n° 10-20.435).
Exemples de mesures ordonnées
Ces mesures ordonnées sur requête peuvent être extrêmement variées : il peut s’agir de
- désigner un huissier de justice afin qu’il assiste à une assemblée générale d’actionnaires (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-16.785, publié au bulletin),
- d’ordonner l’expulsion de salariés grévistes (Cass. soc., 17 mai 1977, n° 75-11.474, publié au bulletin ), de désigner un mandataire ad hoc, etc.
A l’inverse, et compte tenu du caractère provisoire, le juge des requêtes ne peut pas :
- prononcer la nullité d’un acte,
- ordonner le versement de dommages et intérêts
- ou encore établir l’existence d’un droit réel immobilier sur un bien (Cass. civ. 3, 11 mars 2021, n° 20-15.422)
Requêtes nommées : dans les cas particuliers prévus par la loi (Art. 845 alinéa 1)
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans certains cas spécifiés par la loi (CPC art. 845, al. 1).
L’art. 493 ne s’applique pas aux requêtes nommées.
L’urgence n’est pas une condition des requêtes nommées prévue par l’alinéa 1.
La plus connue des requêtes nommées est la requête de l’article 145 du code de procédure civile.
Si l’ordonnance de l’article 145 du code de procédure civile est rendue à la suite d’une requête, toutes les requêtes non-contradictoires ne sont pas rendues sur l’article 145 CPC. Il est possible d’obtenir une ordonnance sur requête sans remplir les conditions de l’article 145 CPC dès lors que les conditions soit de la requête innomée soit d’une autre requête nommée sont remplies.
Si la requête 145 peut sembler hégémonique, il convient de ne pas appliquer ses conditions à toutes les requêtes, dont celles innommées qui peuvent être engagées même en cours de procès.
Me Valentin SIMONNET
Article 145 : perquisition civile
i. Procès futur non encore engagé
ii. Dérogation au contradictoire
iii. Pas d’urgence requise
Le principal texte concerné est l’article 145 du CPC qui permet au juge d’ordonner en référé ou sur requête des mesures d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ici, l’urgence n’est pas requise (Cass. 2e civ. 15-1-2009 n° 08-10.771 : Bull. civ. II n° 15).
Dans le cadre de l’article 145 du CPC, la pratique dominante est néanmoins celle du référé en raison du caractère contradictoire de la procédure. Il ne sera donc possible de présenter une demande aux fins d’obtenir une mesure d’instruction par voie de requête que si le dossier fait apparaître que l’effet de surprise est indispensable pour sauvegarder les preuves.
Procédure d’homologation
L’article 220-1 du code civil
Urgence requise
L’article 257 du code civil
l’appel prévu à l’article 257 du code de procédure civile pour contester une décision avant dire droit qui désigne un expert peut être autorisé sans avoir à se préoccuper du principe du contradictoire.
Urgence requise
L’article 815-6 du code civil
Urgence requise
l’art. 1008 C. civ.
Les autres ordonnances sur requête spéciales
Il s’agit des requêtes nommées
- – de la loi de 1965 sur la copropriété et de son décret d’application, en matière de désignation d’un syndic ou des membres du conseil syndical (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 17 ; Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 46 à 48), d’un administrateur provisoire (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1 B), ou d’un mandataire commun en cas d’usufruit ou d’indivision (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 23) ;
- – du Code de la propriété intellectuelle, en matière de saisie-contrefaçon de logiciels ou de bases de données (CPI art. L 332-4), de dessins et de modèles (CPI art. L 521-4) et de brevets (CPI art. L 615-3) ;
- – du Code de la consommation pour tous les litiges relatifs à celui-ci, lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € (C. consom. art. R. 631-1).
Représentation par avocat dans la procédure sur requête au TJ
Dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, un avocat inscrit au barreau existant auprès du tribunal judiciaire concerné doit présenter la requête. Elle peut également être présentée par un officier public ou ministériel, dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur (CPC art. 846, al. 1). Ce dernier cas concerne essentiellement les notaires, plus rarement les huissiers.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie (CPC art. 846, al. 2).
Quel juge saisir ?
Président du Tribunal judiciaire
- Litige civil
- Litige prud’hommal
- Litige pénal
La compétence de droit commun du tribunal judiciaire fait de son président le juge des requêtes de droit commun. Si sa compétence s’efface lorsque le litige pour la solution duquel sont requises les mesures d’instruction relève d’une autre juridiction ( Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-15.783 : JurisData n° 2014-014776 . – Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 12-29.913 : JurisData n° 2014-005322 ), il est donc autorisé à statuer dans les matières relevant d’une juridiction qui ne comporte pas de juge des requêtes
La jurisprudence retient aussi la compétence du président du tribunal judiciaire lorsque la mesure est susceptible de concerner plusieurs litiges devant être distribués devant des juridictions différentes ( CA Lyon, 24 nov. 2020, n° 19/08432 ). Une option est donc offerte au requérant, lorsque le litige au fond est de nature à relever pour partie de la compétence de la juridiction dont le président est saisi ( CA Lyon, 28 juill. 2020, n° 19/07598 ). Cette solution s’impose d’autant plus aisément que le résultat d’une mesure peut être utilisé devant une autre juridiction que celle du juge qui l’a ordonnée.
Président du tribunal de commerce
En cas de litige relevant la matière commerciale
Requête présidentielle devant le conseil de prud’hommes
Le Conseil de prud’hommes n’ayant pas juge disposant de pouvoirs sur requête , le président du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner sur requête la production de pièces destinées à une instance prud’homale ( Cass. soc., 12 avr. 1995 : Bull. civ. V, n° 134 ) ou pour statuer sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans la perspective d’un potentiel litige relevant de la compétence de la juridiction prud’homale ( Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-17.818 ).
En l’absence de disposition spécifique, le conseil de prud’hommes ne peut pas statuer par ordonnance sur requête ( Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 93-10.982 : JurisData n° 1995-000856 ; Bull. civ. V, n° 134 ; RTD civ. 1995, p. 953 , obs. R. Perrot).
Requête non-contradictoire pour un procès en cours
Contrairement à ce que pensent beaucoup de praticiens, il est tout à fait possible de présenter une requête non-contradictoire alors que le procès est déjà en cours, même en présence d’un juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sorit présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Il en résulte que seul le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut être saisi d’une requête aux fins de voir ordonner une mesure non contradictoire, lorsque la requête est afférente à une instance en cours.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, qui sont limitativement définis aux articles 781 et suivants du code de procédure civile et notamment à l’article 789 invoqué par le requérant, de connaître d’une requête aux fins de mesure non contradictoire. Il sera rappelé qu’en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par voie de conclusions.
Par conséquent, il faut présenter sa requête au Président de la chambre et non au juge de la mise en état, même s’il a été nommé.
Comment présenter une requête au tribunal judiciaire (modalités) ?
Il faut s’adresser au service “requête présidentielle”.
La requête doit être présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée et comporter en bordereau l’indication des pièces. Les pièces en question doivent être jointes au dossier soumis au président ou au juge des contentieux de la protection. Si une juridiction du fond est d’ores et déjà saisie, la requête doit le préciser (CPC art. 494, al. 1 et 2).
Les pièces doivent être jointes en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée (CPC art. 757, al. 1). Toutefois, lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces ne doivent être jointes qu’en un seul exemplaire (CPC art. 757, al. 3).
La requête doit être déposée au greffe de la juridiction. Elle peut être présentée au domicile du juge en cas d’urgence extrême (CPC art. 494, al. 3).
Paris
Pour Paris, les requêtes peuvent être adressés :
- Par voie postale : Tribunal judiciaire de Paris, Pôle de l’urgence civile, Parvis du Tribunal de Paris, 75 859 Paris Cedex 17
- Par dépôt au choix (en échange de la preuve du dépôt de leur requête) [source SN/RF/ACE/658] :
- A l’accueil dédié situé au 6ème étage
- A l’accueil des référés situé au 6ème étage du socle dans le bureau 6.20, entre 9h00 et 17h00
- Au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) civil situé côté nord dans l’enceinte du Tribunal de Paris, tous les jours de 9h00 à 18h00
- La permanence est l’après-midi de 14h à 15h30
Leurs coordonnées de contact sont requetes.civil.tj-paris@justice.fr – 0144325331
Président du tribunal
Tribunal judiciaire de Paris
Pôle de l’urgence civile
Parvis du Tribunal de Paris
75 859 Paris Cedex 17
Tribunal judiciaire de Nanterre – requête présidentielle
Dépôt papier au :
“Président du tribunal
Tribunal judiciaire de Nanterre
Bureau d’Ordre Civil (BOC)
Bureau 1.29
6, rue Pablo Néruda
92020 NANTERRE CEDEX”
Audiences sans avocat les mercredi et vendredi matin
Pas de possibilité de la soutenir
Signature
Lorsqu’une requête adressée au président d’un tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) n’est pas signée par un avocat postulant auprès de ce tribunal, elle est nulle pour irrégularité de fond, peu important dès lors que cette absence de signature n’ait été à l’origine d’aucun grief, cette nullité, en outre, pouvant être proposée en tout état de cause (art. 118 et 119 NCPC) (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-11.718)
Quels sont les effets d’une ordonnance sur requête ?
L’examen du dossier a lieu dans le secret du cabinet du juge, le magistrat examinant la requête et les pièces qui lui sont soumises.
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire, exécutoire immédiatement sur simple présentation de l’original du document (CPC art. 495, al. 2). Copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (CPC art. 495, al. 3), étant entendu que les pièces invoquées à l’appui de la requête ne sont pas visées par cette communication (Cass. 2e civ. 14-1-2021 n° 20-15.673 F-PBI).
L’obligation de communiquer la requête et l’ordonnance ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; par suite, dans le cas où les mesures d’instruction sollicitées doivent s’exécuter dans les locaux d’une société, cette société est la seule personne à laquelle l’ordonnance peut être opposée (Cass. 2e civ. 13-11-2015 n° 13-27.563 FS-PB : Bull. civ. II n° 251).
L’huissier de justice qui, en exécution d’une ordonnance le désignant sur le fondement de l’article 145 du CPC, s’est rendu sur les lieux de sa mission et a justifié de sa qualité, sans pouvoir exécuter cette mission, n’est pas tenu de laisser à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée la copie prévue par l’article 495 CPC (Cass. 2e civ. 30-11-2016 n° 15-15.035 FS-PB : RJDA 2/17 n° 143).
Comment obtenir les pièces de la requête ?
L’article 495, alinéa 3 du CPC n’enjoint de laisser à la personne à qui la mesure est opposée que la seule copie de la requête et de l’ordonnance à l’exclusion des pièces qui ont été invoquées à l’appui de la requête (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 20-15.673 ).
Dans l’affaire soumise sur pourvoi à la Cour de cassation (Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 20-15.673 , F-P+I), il était reproché au juge d’avoir refusé la rétractation, alors que l’huissier de justice chargé d’exécuter la mesure d’instruction avait laissé une copie de la requête et de l’ordonnance sans les pièces invoquées à l’appui de la requête. Il est certain que la connaissance des pièces rend plus effective la possibilité de se défendre, mais le code de procédure civile n’exige pas que les pièces soient jointes à la requête (qui doit seulement « comporter l’indication précise des pièces invoquées », C. pr. civ., art. 494). En conséquence, la Cour de cassation fait une application stricte des exigences prévues à l’article 495 du code de procédure civile qui impose la remise de la requête et de l’ordonnance, à l’exclusion des pièces…
Il en résulte que « l’intéressé » (au sens de l’article de l’article 496 alinéa 3) devra donc « payer pour voir », comme disent les joueurs de poker, c’est-à-dire assigner en rétractation, et demander dans son assignation la communication des documents qui ont fondé la requête critiquée et à défaut de cette communication, la rétractation de l’ordonnance.
Ce n’est qu’en assignant en rétractation et en demandant la communication des pièces à l’occasion de la voie de recours que le défendeur pourra avoir accès aux documents qui ont convaincu le juge.
Il ne fait aucun doute que, dans ce cadre désormais pleinement contradictoire, le requérant à l’ordonnance querellée devra communiquer les pièces produites à l’appui de sa requête à peine de voir l’ordonnance rétractée. Et de voir également les actes qui en découlent annulés, puisque telle est généralement la conséquence d’une telle annulation, comme l’a estimé la deuxième chambre civile dans un arrêt du 23 février 2017) : « Attendu que saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ». Civ. 2e, 23 févr. 2017, nos 15-27.954 et 16-10.895.
Modes de contestation de l’ordonnance sur requête : quels recours ?
Comment contester une ordonnance sur requête : le référé rétractation et l’appel gracieux
Conclusion
L’ordonnance sur requête est une procédure rapide et efficace pour obtenir des mesures urgentes ou des mesures d’instruction avant tout procès. Elle permet au demandeur d’agir sans appeler la partie adverse lorsque les circonstances le justifient. Toutefois, cette procédure n’est pas sans risque puisque l’ordonnance sur requête peut être remise en cause par la voie de la rétractation ou de l’appel. Il convient donc d’être prudent dans le choix et la motivation de sa demande.
| Procédure sur requête | Conditions | Modalités | Effets | Recours |
|---|---|---|---|---|
| Décision provisoire et non contradictoire du président du TJ ou du juge des contentieux | – Cas prévus par la loi – Mesures urgentes nécessitant une dérogation au contradictoire – Motif légitime – Urgence – Intérêt à agir | – Requête motivée et accompagnée des pièces – Présentation par un avocat ou un officier public ou ministériel – Dépôt au greffe ou présentation au domicile du juge | – Exécution immédiate sur simple présentation – Possibilité de suspension par le juge – Communication obligatoire à la personne opposée | – Référé devant le juge qui a rendu l’ordonnance – Appel en cas d’admission ou de rejet |
Modèle de requête non contradictoire
REQUÊTE À M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE…
Monsieur X (état civil, adresse)
Ayant pour avocat Maître Valentin SIMONNET du barreau de Paris qui se constitue pour lui sur la présente et ses suites
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu'il est copropriétaire au 1er étage, au sein d'un immeuble sis à… (adresse) ;
Que le local situé dans le même immeuble au RDC a été loué à un exploitant de bar discothèque ;
Que la réception de la clientèle dans cet établissement donne lieu à de nombreux débordements en raison des activités nocturnes ;
Que les instruments de diffusion de la musique ne sont pas réglés pour tenir compte des inconvénients de voisinage ;
Que les démarches amiables entreprises jusqu'alors avec le gérant de la société exploitante sont restées infructueuses ;
Que la sauvegarde des intérêts du requérant impose qu'il puisse faire constater ces agissements ;
Qu'il est nécessaire de procéder de façon non contradictoire ;
Qu'en effet, s'il était prévenu à l'avance, le gérant de l'établissement ne manquerait pas de prendre, au moins pendant un certain temps, des précautions pour se conformer en apparence à des relations de bon voisinage ;
Qu'il y a urgence, compte tenu de l'impact de cette situation sur la santé du requérant.
C'EST POURQUOI ce dernier vous demande de bien vouloir désigner tel huissier pour procéder à un constat conformément aux dispositions des articles 493 et 845 du Code de procédure civile.
(Date et signature de l'avocat)
Bordereau des pièces produites
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de…,
Vu les dispositions des articles 493 et 845 du CPC,
Désigne Maître Z, Huissier de justice à la Résidence de…, avec mission de :
- se rendre au 1er étage et au RDC de l'immeuble sis à… (adresse)
- dresser un constat des nuisances sonores…
Rappelle que tout intéressé peut en référer au juge signataire de la présente décision.
Rappelle que le double de cette ordonnance doit être conservé au greffe.
Rappelle que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Rappelle que copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Fait à…, le
Le Président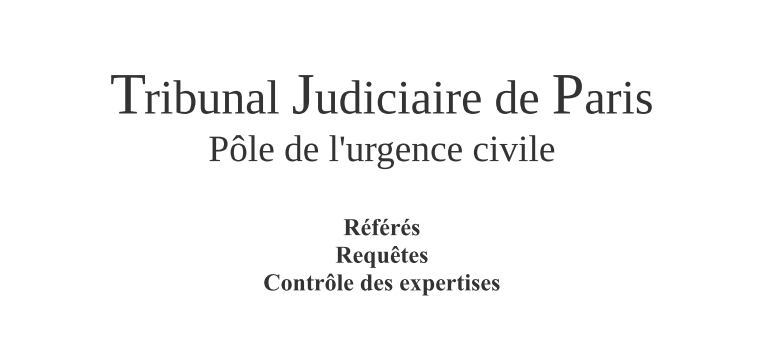
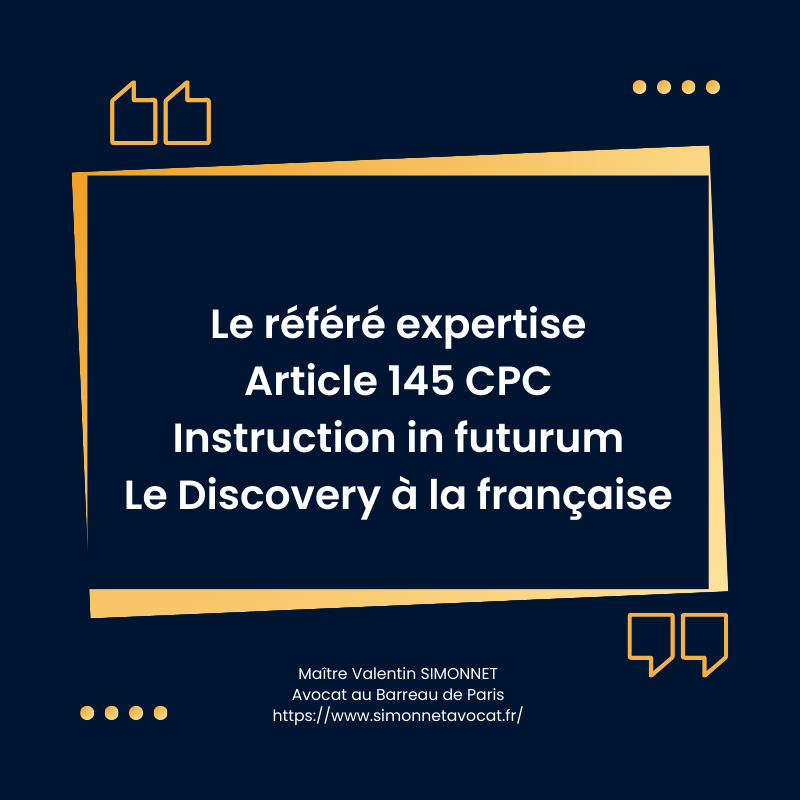
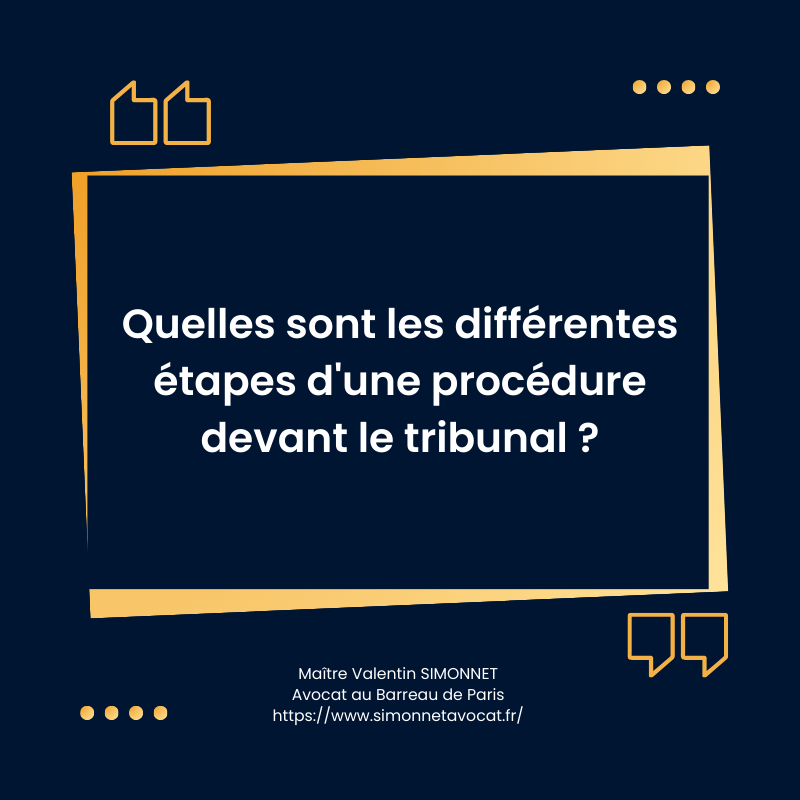
Je désire obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre de la Banque postale pour avoir dissimilé deux copies originales de deux procurations notariées établies en ma faveur par des particuliers pour pouvoir effectuer des retraits sur leurs comptes domiciliés à la Banque postale de Marseille + la non exécution d’une décision de Mr le Médiateur de la banque postale rendue à son encontre depuis plus de 12 mois ?