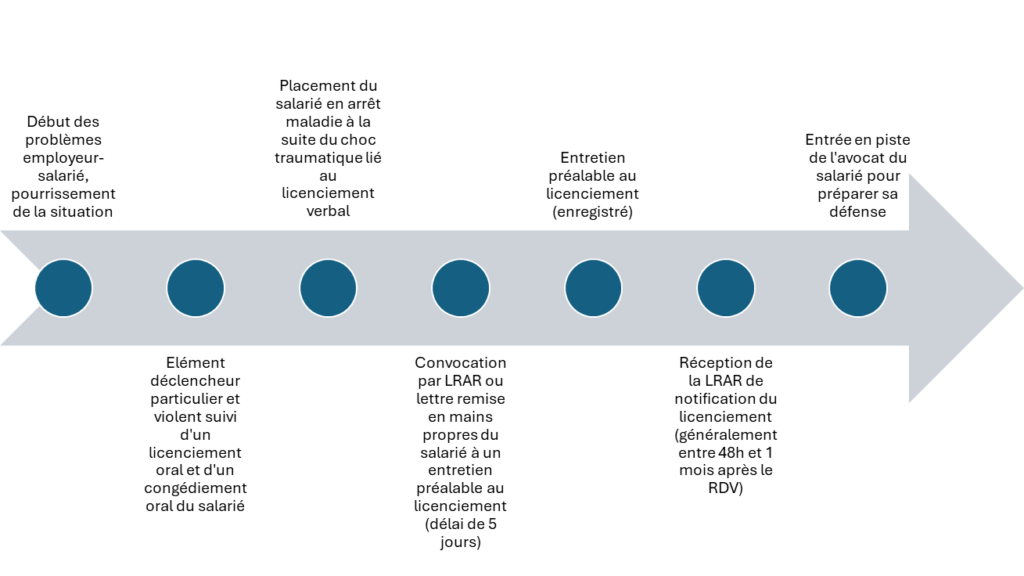La réalisation d’aménagements d’un copropriétaire au sein de son lot ou en dehors de celui-ci cristallise les passions.
Pour certains, toute modification implique l’aval du syndicat. Certains exécutants considèrent pour leur part, qu’ils jouissent d’un pouvoir absolu pour les opérations accomplies dans leur appartement et/ou dans l’espace extérieur contigu privatif ou à jouissance exclusive.
Nous nous proposons de dresser un état des lieux du dispositif législatif applicable et des incidences dans la négative.
Travaux en copropriété: faut-il obtenir l’accord de la copropriété ?
Pour réaliser des travaux affectant impactant les parties communes, le copropriétaire doit impérativement obtenir l’autorisation préalaable de l’assemblée générale. Dans certains cas il est possible en cas de refus de l’assemblée générale, d’être autorisé à réaliser des travaux par le juge.
Les travaux sans nécessité d’autorisation
Il me semble également de rappeler brièvement que certains travaux, n’affectant pas les parties communes ne nécessite pas d’autorisation de l’assemblée générale.
Les travaux n’affectant pas les parties communes ne nécessite pas d’autorisation de l’assemblée générale. C’est-à-dire que le copropriétaire peut les engager sans besoin de soumettre une résolution en ce sens.
Le simple déplacement par un copropriétaire de sa cuisine ou d’une pièce d’eau au sein de son appartement ne nécessite pas d’accord du syndicat, dès lors qu’il n’intervient pas directement sur une alimentation ou une évacuation commune.
La compétence de l’assemblée générale
Les travaux affectant les parties communes que souhaite réaliser un copropriétaire peuvent ressortir de trois majorités distinctes :
- la majorité de l’article 25
- la majorité de l’article 26
- l’unanimité
Si les travaux sont votés à la mauvaise majorité l’autorisation peut être annulée lors d’un recours en nullité de la résolution.
Les travaux sans appropriation de parties communes (art 25)
La loi du 10 juillet 1965 prévoit en son article 25 al. b l’obligation d’autorisa tion de l’assemblée générale pour les travaux d’un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. L’article 25 s’entend des décisions impliquant en première lecture l’obtention de la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires. Il s’agit par exemple de l’installation (ou du rem placement par un modèle différent quant à ses dimensions, matériaux, sens d’ouverture, coloris) de volets roulants, de stores, de fenêtres, de la porte palière de son logement, de la constitution d’un box sur son empla cement privatif de stationnement, de la destruction intégrale ou partielle d’un mur porteur intérieur…
Le requérant doit notifier (LRAR) au syndic pour inscription à l’ordre du jour de l’assemblée (avant que celui ci n’expédie la convocation aux copropriétaires) selon l’article 10 du décret du 17 mars 1967 :
- sa question;
- son projet de résolution;
- le document attestant de la consis tance et de l’implantation des aménagements envisagés. Autre ment dit, cette disposition n’impose pas un dossier technique exhaustif Pour autant, il est de l’intérêt du demandeur de fournir un maximum d’informations à annexer à la convocation, afin de favoriser un vote positif et éclairé des autres copropriétaires. Dans le cas contraire, le requérant s’expose à un refus légitime du syndicat.
Il nous faut insister sur le fait, que l’au teur de la demande doit être un copropriétaire (art.10 du décret). Cela signifie, que si elle émane d’un locataire, elle devra transiter par son bailleur.
Cet aval du syndicat ne se confond pas avec l’éventuelle autorisation administrative obligatoire pour des travaux modifiant la façade de l’immeuble, un bâtiment classé ou dans une zone sauvegardée (art. R 421-17 du Code de l’urbanisme). il s’agit de deux régimes juridiques autonomes et complémentaires.
Les travaux constituant une appropriation des parties communes (art 26)
La procédure connait quelques diver gences, lorsque les travaux souhaités par un copropriétaire s’analysent en une appropriation des parties communes.
Cela concerne par exemple un nouvel empiètement de la porte d’entrée de son appartement dans le couloir ou encore la pose d’une véranda (avec fondations) sur la cour ou le jardin commun à jouissance exclusive.
Dans ce cas, le demandeur devra préalablement solliciter d’un notaire un projet d’avenant au règlement de copropriété proposant un nouveau lot issu de la partie commune, en lui associant:
- un numéro;
- des millièmes de propriété de par ties communes générales et spéciales (si l’immeuble en com porte) ;
- des tantièmes de charges com munes générales, voire spéciales destinés à répartir sa contribution aux frais de fonctionnement de la résidence (art. 10 de la loi);
- un nombre de voix pour délibérer en assemblée (art. 11, 24, 25, 26 de la loi).
Une fois le document établi, ce copropriétaire devra notifier au syndic pour inscription à l’ordre du jour de l’assemblée (art. 10) son projet d’acquisition de la partie commune, soit:
- la question d’achat avec un prix fixé selon l’état du bien immobilier, sa catégorie et sa surface;
- le projet de résolution ;
- la proposition d’avenant au règle ment de copropriété (art. 11 al. 6 du décret).
L’approbation de cette mutation requiert en première lecture la double majorité de l’article 26 de la loi (al. a), à savoir une délibération réunissant l’adhésion de la majorité absolue de tous les copropriétaires regroupant au moins les 2/3 des voix du syndicat. L’assemblée étant souveraine, les co propriétaires peuvent parfaitement décliner la cession de parties com munes sans avoir à se justifier.
Dès lors que l’appropriation des par ties communes affecte l’harmonie de la résidence, il faudra au demandeur distinguer le volet de l’autorisation des travaux, qui relève d’une majorité divergente (art. 25 de la loi). Cet aval peut bien évidemment s’opérer à la même assemblée en se conformant à la procédure réglementaire prévue par l’article 10 du décret énoncée précédemment.
La compétence du juge
Si l’assemblée est l’organe décision naire, le copropriétaire qui entend réaliser à ses frais des travaux impactant les parties communes jouit néanmoins d’une alternative judi ciaire (art. 30 de la loi). Cette solution bis n’en demeure pas moins soumise à de nombreuses conditions.
Tout d’abord, elle ne peut porter que sur les simples aménagements privatifs sur les parties communes, et aucunement des opérations représentant une appropriation de celles-ci. Ce point est néanmoins sujet à discussion.
D’autre part, elle suppose que ce copropriétaire ait antérieurement requis de l’assemblée l’autorisation nécessaire. La saisine judiciaire ultérieure suppose donc un refus préalable du syndicat.
De plus, ce copropriétaire poursuivant et opposant (vote favorable à la décision de rejet) devra solliciter du juge dans le délai de deux mois sui vant la notification du procès-verbal de l’assemblée:
- la nullité de la résolution du syndi cat (art. 42 de la loi);
- l’autorisation judiciaire de les exécuter (art. 30).
Ce recours contentieux doit se fonder sur un refus manifestement abusif du syndicat. Cela signifie, pour le copropriétaire éconduit, de démontrer une exclusion objectivement injustifiée de son projet de travaux, celui-ci présentant toutes les garanties quant à l’es thétique et/ou la sécurité du bâti.
Le magistrat saisi apprécie souverai nement les arguments des deux parties.
La réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation : entre régularisation (rare) et sanction (souvent)
De quels travaux parle-t-on ?
Les travaux seraient irréguliers quand bien même, en l’absence d’une nouvelle autorisation, ils seraient de même nature, mais plus importants que ceux autorisés(Civ. 3e, 2 mars 1994, no 92-11.222 , NP, RDI 1994. 303, obs. P. Capoulade et C. Giverdon – Lyon, 25 avr. 2001, RG no 1999/07465,), ou constitueraient le remplacement de travaux précédemment autorisés(sauf prescription de l’action pour les travaux initiaux,).
Le régime de la copropriété étant indépendant du droit de l’urbanisme, la ratification peut concerner des travaux exécutés sans autorisation administrative, mais le juge peut ordonner une recherche sur la compatibilité avec la réglementation administrative(Civ. 3e, 21 févr. 1995, no 93-14.194 ).
Régularisation amiable possible : “ratification de travaux non autorisés”
Dans l’hypothèse où le copropriétaire enfreint la loi, un accord a posteriori du syndicat est juridiquement envisageable (Cass. 3eciv. 30 sept 1998, n° 96 – 16689)
Il lui suffit de suivre, après coup, la procédure évoquée ci-dessus, que ce soit aussi bien pour:
- l’autorisation de travaux affectant l’harmonie de l’immeuble (art. 25 de la loi et 10 du décret);
- l’appropriation de parties com munes par ses aménagements (art. 26 de la loi et 10 du décret).
le terme consacré est la “ratification de travaux non autorisés”
Sanction judiciaire
En revanche, quand la voie concertée se révèle infructueuse (vaines mises en demeure expédiées principalement par le syndic), le contentieux se révèle le seul remède à cette infraction. Néanmoins, le poursuivant ne doit pas ignorer les conditions de réussite de cette action.
Les prescriptions civiles applicables
Pour obtenir gain cause, l’instance ne doit pas être introduite hors délai maximal à partir du moment où l’on a eu ou pu avoir connaissance de l’illégalité.
Pour les travaux :
- «ordinaires», ce seuil est fixé à cinq ans (art. 42 de la loi et 2224 du Code civil), CA Montpellier, 1er avril 2021, n° 20 – 0412 ;
- représentant une appropriation des parties communes, le ratio s’établit à trente ans (art. 2272 du Code civil), Cass 3e civ. 21 mars 2000, n° 98 – 20201. Cela revient à dire, qu’au-delà de trente ans, la remise en cause de l’appropriation des parties commune par ces travaux est impossible. En revanche, en l’absence d’approbation en assemblée du modificatif du règlement de copropriété impératif, celui-ci peut être requis judiciairement à tout moment, Cass. 3e civ. 13 septembre 2005, n° 04 – 15768.
Le copropriétaire, auteur des travaux irréguliers, ne peut invoquer l’obtention d’une autorisation administrative, ni une tolérance du syndicat, laquelle n’est pas source de droit.
Intérêt et qualité à agir
Le Syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires via son syndic apparait comme le premier postulant, en sa qualité d’unique représentant légal du syndicat chargé d’administrer la résidence et de veil ler au respect du règlement de copropriété (art. 18 de la loi). Pour ce faire, il doit détenir une autorisation déterminée [objet(s), personne(s)] de· l’assemblée consentie à la majorité relative de l’article 24 de la loi (art. 55 du décret).
Le syndic, par la voie de l’action syndicale, peut demander l’interruption des travaux ou obtenir la démolition de ceux qui ont été exécutés indûment(Civ. 3e, 18 juin 1975, no 74-10.297 , P III, no 208 ; D. 1975. IR 207 – Civ. 3e, 25 nov. 1998, no 96-20.863 , P III, no 223 ; Dossier Csab no 72, févr. 1999, no 22 ; D. 1999. 4 ; AJDI 1999. 527, obs. P. Capoulade), sans avoir à établir l’existence d’un préjudice qui résulte de la violation d’une obligation de la part du copropriétaire qui en est l’auteur(Civ. 3e, 13 mars 1991, Loyers et copr. 1991. 186 – Civ. 3e, 15 janv. 2003, no 01-10.337 , NP, Dossier Csab no 116, mai 2003, no 87 – Civ. 3e, 1er mars 2011, no 10-15.337 ,).
Il a, de plus, été jugé que le syndicat engagerait sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires, s’il omettait de prendre les initiatives qui s’imposent(5).
Tout copropriétaire
De même, tout copropriétaire pourra former la même demande, par une action individuelle, dès lors qu’il existe une atteinte aux parties communes, la Cour de cassation n’exigeant plus, dans le dernier état de sa jurisprudence, la condition de prouver le préjudice subi de ce fait dans la propriété ou la jouissance soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes(Paris, 23e ch. A, 12 janv. 1994, JurisData 020328, D. 1994. Somm. 128 – Paris, 14 juin 1995, JurisData 021669, Loyers et copr. 1995. 490 – Paris, 24 janv. 1992, Loyers et copr. 1992. 185 – Civ. 3e, 3 mars 2004, no 02-17.390, NP, AJDI 2004. 645, obs. C. Giverdon – Civ. 3e, 27 janv. 2009, no 07-15.993 , NP, AJDI 2009. 309 .).
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès(Civ. 3e, 14 janv. 2016, no 14-25.538 ).
Ces procédures civiles peuvent aussi s’exercer par tout copropriétaire, s’agissant de la conservation de leur bien immobilier indivis (parties communes), Cass. 3e civ. 26 janvier 2017, n° 15 – 24030.
Le sort du locataire
Outre la demande principale de remise en état ou de restitution des parties communes, elle pourrait à titre accessoire porter sur la résilia tion du bail, si l’illicéité émane d’un locataire, et ce, par le biais de l’action oblique, Cass. 3e civ. 20 novembre 1994, n° 92 – 19490.
Cette requête devra être précédée d’une mise en demeure (LRAR) au bailleur de contraindre l’occupant de son lot à faire cesser l’illégalité dans un délai déterminé et implique d’assigner également le locataire défaillant.
Charge de la preuve
Enfin, toute instance civile suppose, pour le poursuivant, d’apporter par tout moyen la preuve de ses préten tions (art. 9 du Code de procédure civile). Autrement dit, le syndic pour le compte du syndicat, ou le copro priétaire devra prouver les travaux illicites et l’absence de prescription, à travers des attestations nomina tives datées signées, un constat d’huissier, etc.
Si un copropriétaire jouit d’une cer taine liberté dans l’aménagement de son lot, il n’en demeure pas moins contraint à certaines formalités, dès lors que ses travaux impactent les parties communes.
Si les infractions sont susceptibles de sanctions judiciaires, la victime se doit de les solliciter avant la prescrip tion de l’action des manquements invoqués.
Compétence juridictionnelle
Le caractère de voie de fait ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, en raison de travaux irrégulièrement entrepris(6), a pour conséquence de donner compétence au juge des référés à l’effet de prescrire la démolition des travaux irréguliers et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur(7), au besoin sous astreinte(8). Les dispositions de l’article 809 (al. 1er) du code de procédure civile permettent alors au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite(9).
Quelle responsabilité pour l’acquéreur de bonne foi du fait des travaux du précédent propriétaire ?
Il est très courant qu’un copropriétaire réalise des travaux de manière illicite sans que la copropriété soit ne se rende compte soit ne se décide à agir pour des raisons qui lui sont propres. Le changement de propriétaire à l’occasion d’une vente peut raviver certaines rancœurs et pousser le syndicat des copropriétaires a entreprendre des actions aux fins de remise en état des parties communes à l’encontre d’une nouvelle acquéreur. Ce nouvel acquéreur est bien souvent de bonne foi c’est-à-dire qu’il a acheté en l’état sans penser un seul instant que son vendeur avait réalisé des travaux sans autorisation point point
La question qui se pose est de savoir si le copropriétaire de bonne foi peut opposer au syndicat des copropriétaires sa bonne foi pour échapper à une condamnation à une démolition, remise en état et bien souvent sous astreinte
Dans la plupart des cas, le tribunal estimera que le nouveau copropriétaire est responsable des travaux de celui duquel il tient son droit.
L’acheteur aura une action en responsabilité contre son vendeur, encore fautil le retrouver et qu’il soit solvable.
Questions fréquentes
Voici les questions auxquelles nous avons l’habitude de répondre :
Quels types de travaux nécessitent une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ?
Comment obtenir l’autorisation de réaliser des travaux dans ma copropriété ?
Quels sont les délais pour soumettre une demande de travaux à l’assemblée générale ?
Quels documents doivent être fournis pour la demande d’autorisation de travaux ?
Quelles sont les majorités requises pour l’approbation de travaux en assemblée générale ?
Quels recours sont disponibles si ma demande de travaux est refusée par l’assemblée générale ?
Quels types de travaux peuvent être réalisés sans autorisation préalable ?
Quelle est la procédure pour notifier les copropriétaires des travaux prévus dans les parties communes ?
Comment les coûts des travaux en copropriété sont-ils répartis entre les copropriétaires ?
Quelles assurances doivent être souscrites avant de commencer des travaux en copropriété ?
Quels sont les droits et obligations des copropriétaires pendant l’exécution des travaux ?Comment gérer les nuisances (bruit, poussière, etc.) pendant les travaux en copropriété ?
Quels sont les délais et horaires autorisés pour la réalisation de travaux en copropriété ?
Quels sont les recours en cas de malfaçons ou de non-conformité des travaux réalisés ?
Que faire en cas de dommages causés aux parties communes ou privatives pendant les travaux ?
Quelle est la procédure de remise en état des parties communes après la fin des travaux ?
Quels sont les critères pour la régularisation des travaux réalisés sans autorisation préalable ?
Quels sont les risques juridiques encourus en cas de non-régularisation des travaux ?
Comment régulariser des travaux réalisés sans autorisation après coup ?
Quelles sont les responsabilités du syndic en matière de surveillance et de validation des travaux en copropriété ?