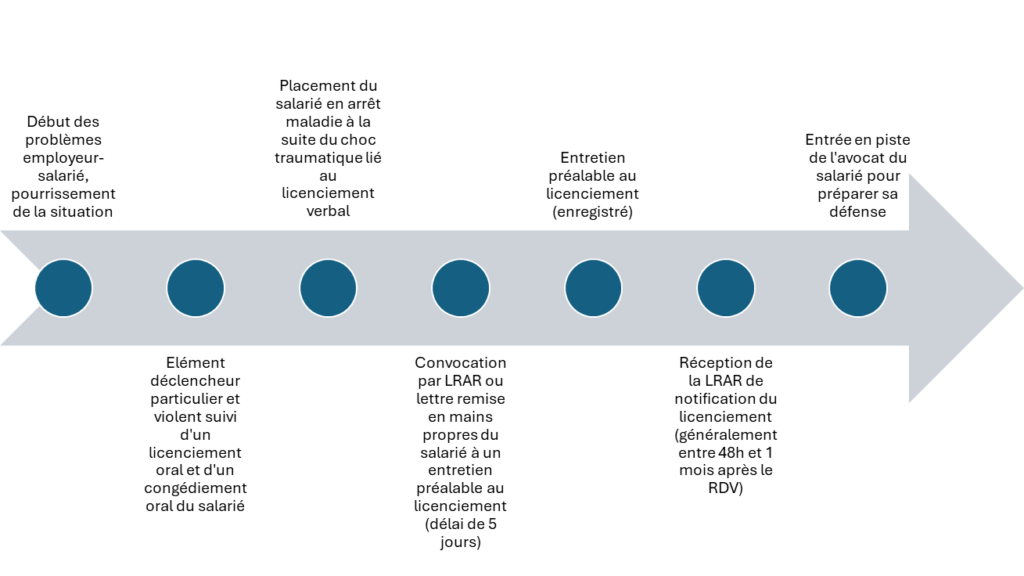La prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles et mobilières court, en principe, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). La formule est connue, mais son application est l’une des zones les plus contentieuses du droit de la responsabilité.
La difficulté devient maximale lorsque l’action en responsabilité s’inscrit dans le prolongement d’une autre procédure : perte d’un procès “source”, condamnation fiscale ou civile imputée à un manquement d’un professionnel, responsabilité d’un intervenant après l’issue d’un contentieux préalable, recours d’un défendeur contre un tiers qu’il estime coresponsable du dommage.
Pendant longtemps, ces configurations ont nourri des solutions hésitantes, parce qu’elles opposent deux risques contradictoires : agir trop tôt, alors que le dommage est encore incertain, ou agir trop tard, en se découvrant prescrit.
Le cadre : article 2224 et logique de l’action utile
L’article 2224 ne se réduit pas à une date de fait générateur. Il renvoie, en réalité, à l’idée que l’action doit pouvoir être exercée utilement : encore faut-il pouvoir caractériser le dommage, et, le plus souvent, articuler un lien de causalité intelligible.
Or, dans les dossiers “adossés” à une autre procédure, il arrive que le dommage soit conditionné par l’issue même du litige préalable. À l’inverse, il arrive que le dommage soit déjà constitué, mais qu’une pluralité de responsables soit susceptible d’en supporter la charge. Dans ce second cas, l’autre litige ne crée pas le dommage : il révèle l’exposition du défendeur à devoir l’indemniser et déclenche la nécessité d’agir contre les coresponsables.
C’est exactement cette différence de nature que la chambre mixte met au centre du raisonnement.
La distinction de la Cour de cassation : deux hypothèses, deux points de départ
Hypothèse 1 : l’action en responsabilité tend à réparer un préjudice dont l’existence dépend de l’issue d’un autre litige
Dans cette première hypothèse (Cass. ch. mixte, 19 juil. 2024, n° 20-23.527, Publié au bulletin) , l’autre procédure est véritablement un litige source : le préjudice invoqué ne peut être regardé comme certain, ou même comme juridiquement constitué, qu’à l’issue de cette procédure.
C’est typiquement le cas lorsque l’on soutient qu’une faute d’un professionnel (notaire, avocat, conseil) a conduit à une condamnation ou à un échec procédural, et que le dommage correspond, en substance, à la perte d’une chance de gagner le procès, à la perte du procès lui-même, ou à la charge financière née d’une condamnation ou d’un redressement.
Tant que la décision n’est pas stabilisée, l’existence du dommage (et parfois sa consistance) demeure incertaine.
Règle de point de départ : décision source irrevocable
La prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où la décision rendue dans le litige source est stabilisée au point de rendre le dommage certain et opposable. En pratique, cela conduit à retenir la date à laquelle la décision devient irrévocable, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours.
Illustration donnée par la chambre mixte (affaire dite du redressement fiscal)
Lorsque des contribuables imputent à leur notaire un montage ayant conduit à un redressement, le délai d’action contre le notaire ne court pas mécaniquement à compter de la notification initiale du redressement, mais à compter du moment où ce redressement est validé de manière stabilisée dans la procédure qui le concerne.
Une précision utile : décision “définitive” et décision “irrévocable” ne se confondent pas
Il faut bien distinguer :
- une décision définitive, qui n’est plus susceptible de voies de recours ordinaires ;
- une décision irrévocable, qui ne peut plus être remise en cause par aucune voie de recours, y compris extraordinaire.
La nuance est décisive en matière de prescription : un arrêt d’appel peut être “définitif” tout en restant “non irrévocable” si un pourvoi en cassation est formé.
Illustration : l’action ne court qu’après la cassation (ou le rejet du pourvoi)
La Cour de cassation a appliqué ce raisonnement à une action en responsabilité engagée à la suite d’un contentieux principal. Dans cette affaire, une société reprochait à une association un manquement (notamment à un devoir de conseil et à une obligation de secret professionnel) qu’elle estimait à l’origine de l’échec d’une action en reconnaissance d’un bail rural verbal. La cour d’appel avait placé le point de départ en 2012, à la date de l’arrêt d’appel. La Cour de cassation censure : le délai ne pouvait courir qu’à compter de la décision rendant l’arrêt d’appel irrévocable, en l’occurrence l’arrêt de 2014 intervenu à l’issue du pourvoi (Cass. 3e civ. 6-11-2025 n° 24-16.853).
Cette approche prolonge la solution retenue par la chambre mixte pour les actions en responsabilité visant à obtenir réparation d’un dommage dont l’existence dépend d’une autre procédure opposant le demandeur à un tiers : le point de départ est la décision juridictionnelle devenue irrévocable (Cass. ch. mixte 19-7-2024 n° 20-23.527 et n° 22-18.729). Elle s’articule enfin avec la distinction classique entre décision définitive et décision irrévocable (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 02-15.893).
Portée pratique
L’intérêt de l’arrêt est double : il confirme que l’on ne se contente pas d’une “connaissance” abstraite du risque, et il impose, en hypothèse 1, un réflexe méthodologique : dater l’irrévocabilité du litige source, en tenant compte des voies de recours exercées. En pratique, dès qu’un dossier de responsabilité “se greffe” sur un contentieux préalable, le réflexe doit être le même : identifier la date d’irrévocabilité de la décision du litige source, car c’est très souvent elle qui commande le point de départ du délai de prescription.
Hypothèse 2 : l’action en responsabilité vise à répartir la charge d’un même dommage entre plusieurs responsables
Dans cette seconde hypothèse (Cour de cassation, Chambre mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729, Publié au bulletin), on n’attend pas qu’un autre litige fasse naître le dommage. Le dommage est déjà identifié : une personne est mise en cause ou poursuivie afin d’indemniser un préjudice unique subi par la victime. Elle estime ne pas être seule responsable et souhaite agir contre un tiers pour obtenir contribution, garantie, ou partage de responsabilité.
Il s’agit, juridiquement, d’une logique d’action récursoire ou de contribution à la dette de responsabilité : le procès principal n’est pas constitutif du dommage, il est le cadre dans lequel la pluralité de responsables doit être organisée.
Règle de point de départ
Le délai commence à courir à compter du jour où une action en justice est engagée contre la personne qui entend exercer ensuite un recours contre d’autres responsables. Autrement dit, le déclencheur n’est pas la condamnation définitive, mais la mise en cause.
Tempérament
La chambre mixte ajoute un garde-fou : le délai ne court pas si la personne poursuivie rapporte la preuve qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’identité des autres responsables au moment où elle a été mise en cause.
Illustration donnée par la chambre mixte (affaire dite du notaire contre l’avocat)
Un notaire poursuivi par un client ou un héritier estime qu’un avocat a contribué au même dommage. Le point de départ de son action contre l’avocat est fixé à la date à laquelle le notaire apprend qu’il est poursuivi, et non à la date à laquelle il sera ultérieurement condamné.
Une frontière parfois délicate : méthode de qualification
Les deux hypothèses peuvent se ressembler, parce qu’elles impliquent toutes deux un “autre litige”. La distinction ne tient pas à la simple existence d’une procédure préalable, mais à la fonction de cette procédure dans la naissance du dommage.
Un test opérationnel en trois questions
Première question
Le dommage que je prétends réparer existe-t-il indépendamment de l’issue du litige source, ou bien est-il conditionné par cette issue
Si le dommage est conditionné par l’issue, on est dans l’hypothèse 1.
Deuxième question
Mon action vise-t-elle, au fond, à obtenir réparation de la perte d’un procès, de la reconnaissance (ou du rejet) d’un droit dans une autre procédure, ou d’une charge née d’une condamnation dont l’existence même reste discutée
Si oui, l’hypothèse 1 s’impose.
Troisième question
Suis-je déjà poursuivi pour indemniser un dommage unique, et ma démarche consiste-t-elle surtout à faire contribuer un tiers que j’estime coresponsable
Si oui, il s’agit de l’hypothèse 2, avec un point de départ fixé à la mise en cause.
Un point d’attention contentieux
Le risque est souvent plus élevé si l’on traite un dossier relevant de l’hypothèse 2 comme s’il relevait de l’hypothèse 1. Attendre la fin irrévocable du procès principal alors qu’une action a déjà été engagée contre soi peut conduire à la prescription du recours contre le coresponsable, sauf à pouvoir démontrer l’impossibilité d’identification.
Décision définitive et décision irrévocable : la précision qui fait varier la date
Dès qu’on raisonne selon l’hypothèse 1, une confusion est fréquente : une décision peut être définitive au sens où elle n’est plus susceptible d’appel, tout en restant susceptible de pourvoi. Or, lorsqu’un pourvoi est exercé et que l’existence ou la consistance du dommage demeure conditionnée par son issue, la date pertinente est celle de l’irrévocabilité.
En pratique, la date utile dépend du calendrier des voies de recours effectivement exercées et de leur incidence sur la certitude du dommage.
Conséquences pratiques : une check-list de sécurisation
- Qualifier le dossier selon la distinction de la chambre mixte
Préjudice conditionné par l’issue d’un litige source ou action récursoire visant un partage de responsabilité pour un dommage unique. - Identifier l’événement déclencheur correspondant
Hypothèse 1 : stabilisation du litige source, date d’irrévocabilité à documenter.
Hypothèse 2 : date de mise en cause, date de l’assignation ou de l’acte introductif dirigé contre le demandeur au recours. - Consolider la preuve des dates
Actes de signification, dates de recours, arrêts rendus, éléments établissant la connaissance ou l’impossibilité de connaître l’identité d’un coresponsable. - Anticiper la stratégie procédurale
Selon le cas, organiser l’appel en garantie et la mise en cause des tiers sans attendre, ou au contraire éviter une action prématurée lorsque le dommage reste conditionnel.
Conclusion
Le point de départ de la prescription n’obéit pas à un automatisme lorsque l’action en responsabilité se greffe sur une autre procédure. Depuis les arrêts de chambre mixte du 19 juillet 2024, la question préalable est toujours la même : l’autre litige conditionne-t-il l’existence du préjudice, ou n’est-il que le cadre dans lequel une pluralité de responsables doit être organisée pour un dommage unique.
C’est cette qualification, plus que la recherche d’une date “intuitive”, qui doit guider la computation du délai et la stratégie contentieuse.
Si vous êtes confronté à un dossier où le point de départ est discuté, ou si vous hésitez entre ces deux hypothèses, vous pouvez me contacter : l’enjeu se joue souvent sur quelques dates et sur la qualification exacte du dommage invoqué.
Mon avis de praticien
La distinction opérée par la chambre mixte est, sur le papier, particulièrement séduisante. Intellectuellement, elle “tient” : d’un côté, le préjudice dont l’existence dépend de l’issue d’un litige source ; de l’autre, le même dommage à répartir entre plusieurs responsables, ce qui justifie un point de départ avancé au jour de la mise en cause.
Mais, pour aussi élégante qu’elle soit sur un plan juridique, cette grille de lecture résiste, en réalité, assez mal à la pratique quotidienne du contentieux et aux complexités de fait auxquelles sont confrontés les juges du terrain, en première instance comme en appel.
Dans les dossiers réels, les situations sont rarement binaires. Les faits sont multidimensionnels : il peut y avoir un enchevêtrement de procédures, des dommages successifs ou composites, des causalités discutées, une connaissance progressive des manquements, des intervenants multiples dont le rôle n’est identifié qu’au fil de l’instruction, et, très souvent, des stratégies contentieuses qui font varier la perception du “moment” où l’action pouvait être exercée utilement. Autrement dit, ce qui, en droit, relève de catégories relativement nettes, devient, dans les faits, un objet beaucoup plus flou, et donc plus discutable.
C’est précisément pour cela que ce guide est utile, et que la décision de la chambre mixte est, à mon sens, pertinente : tout ce qui contribue à clarifier une zone historiquement instable est bienvenu. Reste qu’il ne faut pas se raconter d’histoires : la qualification proposée conserve une part de subjectivité et demeure, par nature, exposée à des interprétations divergentes selon les juridictions, les formations, et parfois même les dossiers.
Or, les conséquences pratiques sont radicales. D’un côté, l’action est recevable ; de l’autre, elle ne l’est pas. Et lorsque la prescription est retenue, c’est souvent “fin de partie”, sans rattrapage possible.
C’est la raison pour laquelle, par prudence contentieuse, je recommande une approche de “ceinture et bretelles” : lorsque l’on est encore dans les délais possibles, il est généralement préférable d’assigner, quitte à solliciter ensuite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du litige source si l’appréciation du dommage demeure dépendante de cette issue.
Le contentieux consiste aussi à s’interdire d’ouvrir des portes à la défense adverse. Il serait dommage de se créer un débat autonome sur la prescription, potentiellement évitable, en pariant sur une qualification qui, dans un cas limite, pourrait être appréciée différemment par un juge de première instance ou une cour d’appel. L’assignation conservatoire, lorsqu’elle est juridiquement tenable, protège contre cet aléa : elle sécurise la recevabilité, puis permet de demander au juge de temporiser sur le fond, le temps que le litige “source” se stabilise.
En résumé : la distinction de la chambre mixte est un cadre précieux, mais dans les dossiers frontières, la stratégie la plus sûre reste souvent d’agir dans le délai et de gérer ensuite le calendrier judiciaire (notamment via un sursis à statuer) plutôt que de laisser la prescription devenir, à elle seule, le cœur du procès.