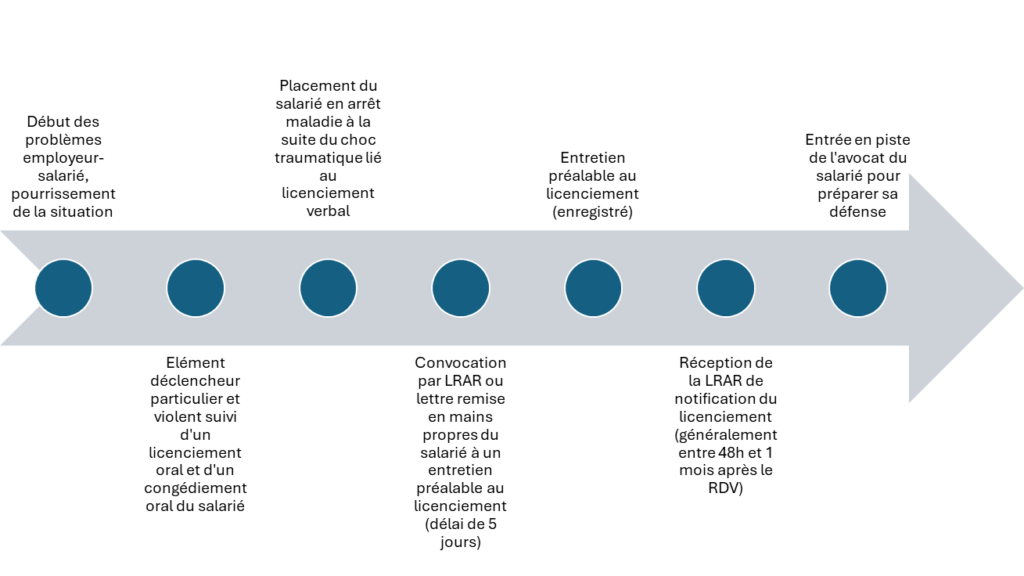Le classement sans suite
Au tout début de la procédure, lorsque le procureur détermine qu’il n’y a pas assez d’éléments pour engager une poursuite judiciaire, il fait un classement sans suite. 73,75 % des affaires traitées en 2016 ont été classées sans suite.
Classement sans suite : qu’est-ce que ça signifie en pratique ? (infraction insuffisamment caractérisée, etc.)
Innocence, culpabilité, coupable
Contrairement à une idée largement répandue, l’innocence n’est pas une notion juridique autonome. Le droit français ne connaît que deux états :
la présomption d’innocence et la culpabilité.
On est coupable ou non coupable.
Et si l’on est déclaré non coupable, c’est soit parce que l’on n’a rien commis, soit parce qu’il n’a pas été démontré que l’on a commis une infraction. La nuance est fondamentale.
La présomption d’innocence : un principe fondateur
En droit, tout individu est réputé innocent a priori. C’est précisément le sens de la présomption d’innocence. Elle s’impose avant même toute décision de justice, et elle demeure jusqu’à l’éventuelle condamnation définitive.
Est innocent celui qui n’a pas été condamné.
Autrement dit, on n’est pas innocent après le jugement :on l’est avant, pendant, et jusqu’au bout, tant que la culpabilité n’est pas légalement établie.
Ce principe fondamental est garanti par :
- l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
- l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
- et, depuis 2000, par l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
La présomption d’innocence est l’un des piliers de toute société démocratique. Elle protège contre l’arbitraire, contre l’emballement médiatique, contre l’idée dangereuse selon laquelle une accusation vaudrait déjà condamnation.
On ne déclare jamais quelqu’un « innocent »
Aucune juridiction, en France comme ailleurs, ne rend jamais un verdict d’innocence. Ce serait juridiquement absurde : on ne déclare pas ce qui est déjà acquis en droit.
Le jury américain répond simplement : “guilty” (coupable) ou “not guilty” (non coupable).
En France, les jurés statuent par « oui » ou par « non » à une seule question : « L’accusé est-il coupable d’avoir… ? » (article 357 du Code de procédure pénale).
Ils ne votent :
- ni sur l’innocence,
- ni sur le doute,
- ni sur une vérité philosophique.
Ils répondent à une question de culpabilité.
Et dès lors que la majorité requise n’est pas atteinte, l’acquittement est prononcé. Que l’accusé ait manifestement été étranger aux faits ou que subsiste simplement un doute sérieux, le résultat juridictionnel est identique : il est déclaré non coupable.
La justice ne tranche pas la vérité absolue
La pratique du droit pénal dissipe vite l’illusion d’une vérité unique, évidente, incontestable.
La justice ne juge pas la Vérité avec un grand V.
Elle statue sur la base de preuves, de certitudes relatives, parfois fragiles, parfois contradictoires, toujours imparfaites.
Elle ne dit pas : « ceci est la vérité ».
Elle dit : « la culpabilité est — ou n’est pas — juridiquement établie ».
Accusé ne signifie jamais coupable
Une personne mise en cause, dénoncée, poursuivie, reste juridiquement présumée innocente jusqu’au terme de la procédure.
Jusqu’au bout.
C’est précisément ce principe qui distingue l’État de droit de la justice expéditive, de l’émotion, du soupçon devenu verdict.
Non-lieu : le procès n’a aucune chance d’aboutir à une condamnation
Est-on innocent quand on bénéficie d’un non-lieu ?
Le non-lieu est une décision prévue à l’article 177 du code de procédure pénale prise exclusivement par le juge d’instruction à l’issue de l’enquête qu’il a menée.
Après avoir examiné l’ensemble des éléments recueillis, le juge d’instruction peut soit renvoyer le mis en examen devant une juridiction de jugement, soit prononcer un non-lieu.
Le non-lieu est prononcé lorsqu’il apparaît que :
– les faits ne constituent pas une infraction ;
– l’auteur est demeuré inconnu ;
– l’auteur est pénalement irresponsable (en raison d’un trouble mental, par exemple) ;
– ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen.
Le non lieu ne reconnait pas l’innocence. Il signifie seulement qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier pour aller plus loin et condamner.
Le non-lieu n’a pas à proclamer l’innocence du mis en examen, puisqu’il l’est resté tout au long de la procédure, en vertu de la présomption d’innocence.
Si, par exemple, un homme est retrouvé tué de plusieurs balles dans le dos, mais que le tireur n’est jamais identifié, le juge d’instruction rendra un non-lieu.
Cela ne veut pas dire que le meurtre n’a pas eu lieu, mais simplement qu’il n’existe pas de charges permettant de poursuivre quiconque.
Lorsqu’un juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, la personne concernée :
– n’est pas innocentée, puisqu’elle a bénéficié de la présomption d’innocence tout au long de la procédure, même en cas de mise en examen ;
– n’est pas relaxée, car aucune comparution devant un tribunal correctionnel n’a eu lieu ;
– n’est pas acquittée, aucune poursuite devant une juridiction criminelle n’ayant été engagée.
Le non-lieu n’a donc pas la portée d’un acquittement ou d’une relaxe :
– il ne statue pas sur la culpabilité,
– il n’innocente pas,
– il constate seulement l’absence de charges suffisantes.
Le non-lieu procède de divers motifs (CPP, art. 177, al. 1er et 2 , cependant incomplet), que l’on répartit traditionnellement en:
- motifs « de droit » (licéité pénale des faits, présence d’une cause d’irresponsabilité pénale ou d’une immunité de fond, obstacle procédural à l’engagement des poursuites)
- motifs « de fait » (inexistence des faits, impossibilité de découvrir un quelconque suspect ou de réunir des charges suffisants à son encontre).
Le non – lieu ne signifie donc pas nécessairement qu’aucune infraction n’a été commise ou que la personne qui en bénéficie n’est pas coupable.
Le non-lieu n’est pas une simple absence de preuve : c’est la reconnaissance judiciaire qu’un procès n’aurait aucune chance d’aboutir à une condamnation.
Si un procès s’était tout de même tenu, le mis en cause aurait très probablement été relaxé ou acquitté.
Autrement dit, le juge d’instruction met fin à une procédure dont l’issue est déjà certaine : l’absence de culpabilité.
Il s’agit d’éviter un procès inutile, qui n’apporterait rien à la justice ni aux parties.
Un tel procès serait un double échec :
– pour le parquet, qui verrait son dossier s’effondrer en audience publique ;
– pour la partie civile, qui subirait un procès sans condamnation, et donc sans reconnaissance de la qualité de victime.
Le non-lieu, en ce sens, protège la cohérence du système judiciaire : il évite de juger là où le jugement ne ferait que confirmer l’évidence — qu’il n’y avait pas de faute, pas de preuve, pas de culpabilité.
L’ordonnance de non-lieu clôt ainsi l’instruction sans procès, en constatant qu’il n’existe pas de motifs légaux pour renvoyer la personne devant une juridiction de jugement.
Elle n’a pas à proclamer l’innocence du mis en examen, puisqu’il l’est resté tout au long de la procédure, en vertu de la présomption d’innocence.
Plaignant
Le plaignant désigne la personne qui porte plainte, c’est-à-dire celle qui saisit les autorités judiciaires (police, gendarmerie, procureur de la République) pour signaler une infraction qu’elle estime avoir subie.
Le plaignant peut être :
- la victime directe de l’infraction (par exemple, la personne volée, blessée, diffamée, escroquée, etc.) ;
- ou une personne agissant pour la victime, comme un représentant légal (tuteur, parent, avocat, etc.).
Il ne faut pas confondre :
- le plaignant, qui dénonce les faits et enclenche éventuellement une enquête,
- et la partie civile, qui intervient devant la juridiction pénale pour demander réparation du préjudice causé par l’infraction.
Autrement dit, on devient « partie civile » dès lors qu’on participe au procès pénal, alors qu’on reste simplement « plaignant » tant qu’on a seulement déposé plainte.
Partie civile
La partie civile est la personne (physique ou morale) qui se constitue comme telle dans une procédure pénale pour faire valoir les droits de la victime et obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une infraction.
La partie civile est celle qui se constitue comme telle devant le juge d’instruction, le parquet et/ou la juridiction, afin d’avoir accès au dossier, exercer certains droits procéduraux (comme la demande d’acte, la possibilité d’interjeter appel, de formuler des observations, etc.) et solliciter des dommages-intérêts.
La constitution de partie civile permet donc à la victime de participer activement à la procédure pénale, aux côtés du ministère public, tout en poursuivant un but personnel : la réparation de son dommage.
Victime
Une victime, en droit, n’est pas celle qui se dit victime, mais celle qui est reconnue comme telle par la justice.
Cette reconnaissance résulte d’une décision judiciaire définitive, après examen des faits et des preuves. C’est seulement à ce moment-là que la personne peut être indemnisée et bénéficier des mécanismes de solidarité prévus par la loi, comme la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le SARVI.
La distinction est essentielle : on peut se dire victime, mais on ne l’est juridiquement que lorsqu’un juge l’a reconnu.
Autrement dit, le mot « victime » n’a pas le même sens dans la vie courante et devant un tribunal.
La formule souvent reprise — « victime, on vous croit » — entretient cette confusion. Elle relève de l’écoute, de la compassion, du soutien psychologique ; mais elle ne confère aucun statut juridique.
En droit, le juge ne croit pas : il vérifie. Il instruit, pèse les arguments, confronte les preuves. Ce n’est qu’à l’issue de ce processus contradictoire que la qualité de victime peut être officiellement reconnue.
C’est cette rigueur qui garantit la justice : sans elle, toute accusation deviendrait vérité, et toute parole, condamnation.
La mise en examen : l’existence d’indices graves et concordants
La mise en examen n’est pas une condamnation. Ce n’est même pas un signe de culpabilité.
Jusqu’en 1993, on parlait d’inculpation, mais le terme a été abandonné : jugé trop infamant, il laissait croire qu’une personne « inculpée » était déjà coupable.
Aujourd’hui, la mise en examen est décidée par le juge d’instruction, dans le cadre d’une instruction préparatoire, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants laissant penser qu’une personne a pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.
C’est ce que prévoit l’article 80-1 du Code de procédure pénale.
Ces indices ne sont pas des preuves : ce sont des éléments qui rendent vraisemblable une participation, sans la démontrer.
Autrement dit, le juge d’instruction estime qu’il y a matière à enquête approfondie, pas que la personne est coupable.
Le mis en examen n’est pas un coupable, il reste présumé innocent.
La culpabilité, en droit français, ne peut être décidée que par un tribunal, à l’issue d’un jugement contradictoire et d’une décision définitive.
La mise en examen signifie donc une seule chose : il existe des charges contre un justiciable.
Mais les charges, ça se combat. Et c’est précisément pour cela que la Défense existe.
Cette étape a d’ailleurs une fonction essentielle : elle ouvre les droits de la Défense.
Dès la mise en examen, la personne concernée (et son avocat) peut :
– accéder au dossier,
– consulter les pièces,
– demander des actes,
– formuler des observations,
– et contester certaines décisions.
Mettre quelqu’un en examen, ce n’est donc pas le désigner comme coupable :
c’est lui permettre de connaître les charges portées contre lui et de se défendre efficacement.
C’est tout l’esprit de la justice d’instruction à la française : équilibrer l’accusation et la défense, avant tout jugement sur la culpabilité.
Quelles sont les suites de la mise en examen :
- 20 % des personnes mises en examen dans des affaires conclues en 2016 ont bénéficié d’un non-lieu.
- Les 80 % restants ont été renvoyés devant des tribunaux. En 2016,
- 22 013 personnes mises en examen (67 %) ont été renvoyées au tribunal correctionnel, où « le taux de relaxe pour les personnes jugées en audience est de 6,4 % », comme le précise le ministère de la justice.
- 2 300 (7 %) ont été mises en accusation devant la cour d’assises, qui avait un taux d’acquittement de 5,2 % en 2015.
Autrement dit, si vous êtes mis en examen dans une affaire correctionnelle, vous avez 74,88 % de risque d’être condamné par le tribunal.
Le témoin assisté : pas assez d’indices pour être mis en examen
Lorsqu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants laissant penser qu’une personne a commis une infraction, le juge d’instruction ne peut pas la mettre en examen.
Dans ce cas, il ne reste qu’un seul statut possible — en dehors de celui de simple tiers à la procédure : témoin assisté.
Ce statut intermédiaire a des conséquences importantes.
Le témoin assisté ne peut faire l’objet d’aucune mesure coercitive : ni contrôle judiciaire, ni détention provisoire.
C’est la raison pour laquelle beaucoup d’avocats apprécient ce statut « sans risque ».
Mais à mes yeux, c’est un marché de dupes.
Le témoin assisté dispose de droits limités : il ne bénéficie pas de la pleine protection attachée au statut de mis en examen.
Il n’a qu’un accès partiel au dossier et ne peut pas exercer l’ensemble des recours de la Défense.
Surtout, cette sécurité apparente est toute relative : le juge peut à tout moment requalifier son statut et le placer sous mise en examen, dès lors qu’apparaissent des indices graves ou concordants.
(La loi a d’ailleurs assoupli le critère : autrefois, il fallait des indices graves et concordants ; aujourd’hui, il suffit qu’ils soient graves ou concordants.)
Enfin, le témoin assisté lui-même peut demander à être mis en examen.
C’est parfois une stratégie judicieuse : elle permet d’accéder pleinement au dossier et d’exercer tous les droits de la défense, plutôt que de rester dans une zone grise où l’on subit l’instruction sans y participer vraiment.
En somme, le témoin assisté n’est pas encore un mis en examen, mais il n’est déjà plus un simple spectateur.
Un statut à double tranchant : confortable en apparence, mais fragile en réalité.
Instruction judiciaire/instruction préparatoire
L’instruction judiciaire est une enquête confiée à un juge d’instruction, véritable juge enquêteur.
Ce dernier peut être saisi soit par le parquet, dans la majorité des cas, soit par un plaignant qui se prétend victime d’une infraction.
Historiquement, dans le Code d’instruction criminelle — l’ancêtre de notre Code de procédure pénale —, le juge d’instruction intervenait systématiquement pour tout dossier délictuel ou criminel.
C’est encore le cas dans certains systèmes voisins, comme à Monaco.
Mais en France, son rôle a progressivement reculé au profit des enquêtes de police menées sous la direction du parquet.
Aujourd’hui, le juge d’instruction ne traite plus qu’environ 5 % des dossiers pénaux.
Ce chiffre est cependant trompeur : il s’agit des 5 % les plus graves ou les plus complexes.
La loi rend d’ailleurs l’instruction obligatoire en matière criminelle — par exemple pour les affaires de meurtre, de viol ou de vol à main armée.
C’est dire si le juge d’instruction demeure au cœur des procédures les plus lourdes.
Le juge d’instruction “instruit à charge et à décharge” : il doit rechercher la vérité, sans se soucier de savoir si son enquête incriminera ou disculpera telle ou telle personne.
Il n’est pas un accusateur public, et sa mission n’est pas de « faire tomber » quiconque.
Cela ne l’empêche pas, évidemment, de rassembler des éléments à charge, lorsqu’ils existent.
Dire que « le juge instruit uniquement à charge » relève d’une formule commode — et souvent creuse — de plaidoirie défensive.
Elle figure au même panthéon que l’inévitable « le dossier est vide ».
En pratique, le juge d’instruction conduit une recherche équilibrée, et c’est cette neutralité d’enquête qui fonde la spécificité du système français.
Juge d’instruction
Le juge d’instruction est un magistrat du siège chargé de mener les enquêtes judiciaires les plus graves ou les plus complexes, dans le cadre de ce qu’on appelle l’instruction préparatoire.
Il est saisi soit par le parquet, soit par un plaignant qui se prétend victime d’une infraction.
Une fois saisi, le juge d’instruction conduit l’enquête, entend les témoins, ordonne des expertises, délivre des mandats, procède à des interrogatoires et met éventuellement en examen les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants.
Mais il ne juge pas : il instruit, il rassemble les faits, il les vérifie.
Contrairement à une idée répandue, le juge d’instruction ne “reproche” rien à personne.
Il ne fait pas la morale, il ne cherche pas à convaincre ou à punir.
Sa mission est d’établir la vérité des faits, pas de juger les comportements.
Il agit en toute indépendance et doit instruire à charge et à décharge, c’est-à-dire rechercher aussi bien les éléments susceptibles d’accuser que ceux pouvant innocenter.
C’est cette impartialité qui fonde sa fonction : un juge d’enquête, et non un juge de condamnation.
Réquisitoire introductif
Une instruction judiciaire commence toujours par un réquisitoire introductif.
C’est l’acte par lequel le procureur de la République saisit le juge d’instruction et lui demande d’enquêter sur des faits précis.
Le réquisitoire introductif vise les faits sur lesquels le juge doit instruire.
Il peut mentionner le nom d’un suspect, mais ce nom ne lie pas le juge.
Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire des faits, et non in personam (d’une personne).
Autrement dit, il peut mettre en examen toute personne impliquée dans ces faits, mais il ne peut pas enquêter sur d’autres faits dont il n’a pas été saisi, sous peine de nullité.
En pratique, le réquisitoire introductif est un acte assez sobre : il se présente souvent sous la forme d’un document signé du procureur, accompagné des premières pièces du dossier (plainte, procès-verbaux, auditions).
Sa rédaction est standardisée :
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de [ville],
vu les pièces jointes,
attendu qu’il en résulte contre [nom de la personne, ou “X” si le suspect n’est pas encore identifié] des indices laissant présumer qu’il (ou elle) a participé aux faits suivants :
viol sur la personne de [nom de la victime],
faits commis à [lieu] le [date],
prévus et réprimés par les articles 222-22 et suivants du Code pénal,
vu l’article 80 du Code de procédure pénale,
requiert qu’il plaise à Monsieur ou Madame le juge d’instruction d’informer par toute voie de droit. »
À partir de ce moment, le juge d’instruction devient maître de l’enquête.
Le parquet ne dirige plus : il a transmis le dossier, et c’est désormais au juge d’instruction de rechercher la vérité, à charge et à décharge.
Si, au cours de l’enquête, le juge découvre que la personne initialement visée n’est pas l’auteur des faits, mais qu’il s’agit d’une autre, il peut mettre en examen cette autre personne sans demander la moindre autorisation.
Mais si le juge découvre, par exemple, que le même auteur présumé a commis un autre viol, il ne peut pas instruire sur ce nouveau fait sans y être formellement autorisé.
Il doit alors transmettre les procès-verbaux au procureur, qui décidera :
– de prendre un réquisitoire supplétif, élargissant la saisine du juge d’instruction ;
– d’ouvrir une enquête préliminaire distincte ;
– ou de classer sans suite.
Ce mécanisme, parfois perçu comme formaliste, a un sens profond : il garantit que le juge d’instruction ne peut enquêter que dans les limites fixées par la loi et qu’une fois saisi, il instruit en toute indépendance.
C’est cette indépendance qui fait de l’instruction un pilier du procès pénal français, notamment dans les affaires les plus graves ou les plus sensibles.
Article 175 et ordonnance de règlement
VLorsque le juge d’instruction estime que l’enquête est complète, autrement dit qu’il a accompli tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, il en avise les parties conformément à l’article 175 du Code de procédure pénale.
Sont alors informés :
– les mis en examen ;
– les parties civiles (les plaignants qui ont choisi de participer à la procédure) ;
– le parquet ;
– ainsi que le témoin assisté, même s’il n’est pas partie à l’instruction et qu’il est, à ce stade, de facto mis hors de cause.
Cet avis ouvre la phase de règlement.
Durant cette phase, les parties peuvent :
– formuler des observations,
– demander la réalisation d’actes complémentaires (expertise, confrontation, audition, etc.),
– ou, pour le parquet, formuler ses réquisitions sur les suites à donner.
À l’issue de cette phase, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement, qui détermine l’issue de la procédure.
Trois hypothèses principales sont possibles :
- Mise en accusation devant la cour d’assises
Si l’information a permis d’établir des charges suffisantes qu’un crime a été commis par le mis en examen, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en accusation et transmet le dossier à la chambre de l’instruction, qui statue sur le renvoi devant la cour d’assises. - Renvoi devant le tribunal correctionnel
Si les faits constituent un délit, le juge rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ou, plus rarement, devant le tribunal de police en cas de contravention). - Ordonnance de non-lieu
Si l’information n’a pas permis d’établir de charges suffisantes, ou s’il est établi que les faits sont prescrits, amnistiés, que l’auteur est inconnu ou décédé, le juge rend une ordonnance de non-lieu.
Cette décision met fin aux poursuites : elle signifie qu’aucune juridiction de jugement ne sera saisie.
L’ordonnance de règlement clôt ainsi l’instruction.
Elle constitue la frontière entre la phase d’enquête judiciaire et le procès pénal, et détermine si l’affaire doit être jugée ou classée.
Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
L’ordonnance de renvoi est la décision par laquelle le juge d’instruction estime que son enquête a permis de réunir des charges suffisantes démontrant qu’un délit a été commis par la personne mise en examen.
Dans ce cas, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel, juridiction de jugement compétente pour statuer sur les délits.
Le renvoi ne constitue pas une condamnation.
Il marque simplement la fin de la phase d’instruction et le début du procès pénal.
C’est désormais au tribunal qu’il appartient d’examiner les faits, d’entendre la défense, et de décider s’il y a lieu ou non de prononcer une peine.
Une personne renvoyée devant une juridiction de jugement reste présumée innocente tant que celle-ci n’a pas statué sur son cas, et ce, dans le cadre d’une procédure équitable garantissant le plein exercice des droits de la défense.
Autrement dit, l’ordonnance de renvoi ne préjuge de rien :
– elle ne dit pas que la personne est coupable ;
– elle constate simplement que les charges sont suffisantes pour être jugées ;
– et elle ouvre le procès, seul moment où la culpabilité peut être légalement établie.
L’ordonnance de renvoi est donc une décision de transmission, pas de condamnation.
Elle met un terme à l’instruction mais laisse intacte la présomption d’innocence jusqu’au jugement définitif.
Phase de jugement
La décision de relaxe ou d’acquittement possède une force supérieure à celle du non – lieu : une fois définitive, elle éteint l’action publique par la chose jugée et, suivant le principe » non bis in idem », interdit que la même personne soit derechef poursuivie pour les mêmes faits.
Relaxe
La relaxe est une décision de non-culpabilité rendue après un procès devant une juridiction de jugement : le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou, plus rarement aujourd’hui, le tribunal de proximité.
Elle intervient lorsque le tribunal, après avoir examiné les faits, les preuves et les arguments des parties, estime qu’aucune infraction n’est constituée ou qu’il n’existe pas de preuve suffisante pour condamner le prévenu.
La relaxe signifie donc que la personne poursuivie n’est pas reconnue coupable.
Elle met définitivement fin aux poursuites, sauf en cas d’appel du ministère public ou de la partie civile.
La relaxe n’efface pas la présomption d’innocence : elle la confirme.
Elle consacre juridiquement ce que le droit reconnaît depuis le début de la procédure — à savoir que le prévenu est resté innocent tant qu’il n’a pas été condamné.
En résumé :
– la relaxe intervient après un procès devant le tribunal correctionnel ou de police ;
– elle constate l’absence de culpabilité ;
– et elle met fin à la procédure pénale.
Acquittement
L’acquittement est la décision de non-culpabilité rendue par une cour d’assises, à l’issue d’un procès criminel.
Elle intervient lorsque le jury (et les juges professionnels) estime que l’accusé n’a pas commis les faits ou qu’il n’existe pas de preuve suffisante pour le condamner.
L’acquittement met fin à toute poursuite : la personne jugée est définitivement déclarée non coupable des faits criminels qui lui étaient reprochés.
Le ministère public peut toutefois interjeter appel d’un verdict d’acquittement, ce qui donne lieu à un nouveau procès devant une autre cour d’assises.
Comme la relaxe devant le tribunal correctionnel, l’acquittement ne crée pas l’innocence : il la confirme.
L’accusé est resté présumé innocent tout au long de la procédure, et l’acquittement vient juridiquement consacrer cette présomption.
En résumé :
– l’acquittement est rendu par une cour d’assises après un procès criminel ;
– il constate l’absence de culpabilité ;
– il met fin à la procédure ;
– et il confirme la présomption d’innocence de l’accusé.